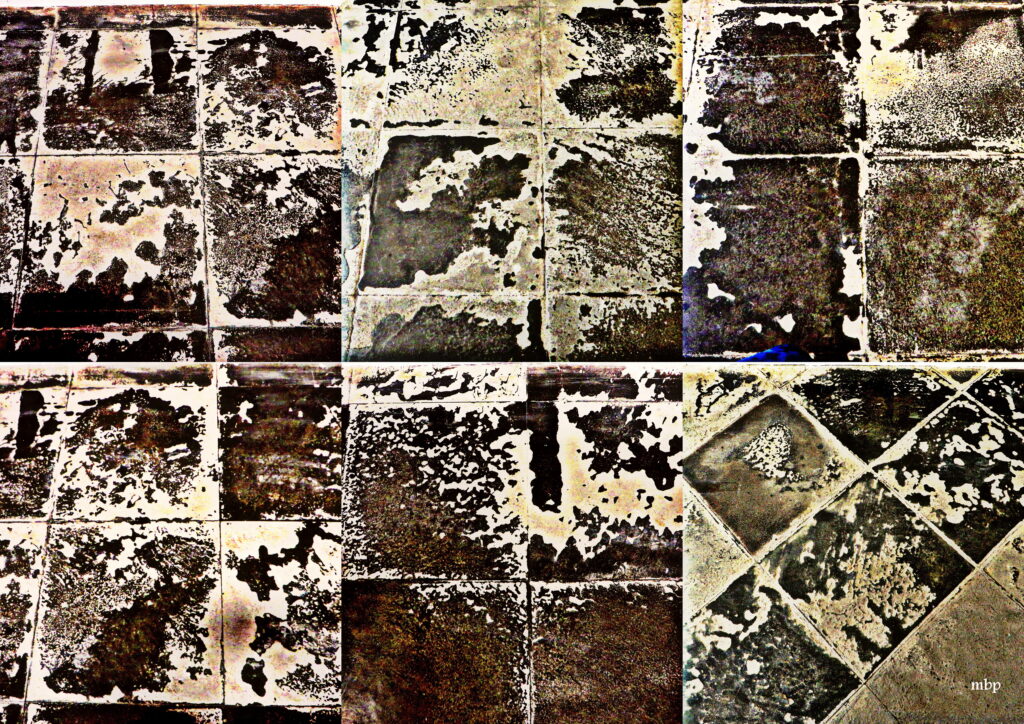photo mbp
.(liste des auteurs dans l’ordre inverse des publications – photos indiquées par *)
Pierre Laroche* (Fr), Michel Ménaché (Fr), Chantal Danjou (Fr), P.Y.Xyn (Fr), Chantal Plaine (Fr), Jean-Christophe Belleveaux (Fr), Rémi Tournier* (Fr), Alain Nouvel (Fr), Chantal Plaine (2) – Béatrice Machet (Fr) – Gérard le Goff (Fr) – Cédric Merland* (Fr) – Xavier Bordes (Fr) – Florence Daudé *(Fr) – Lucilla Trapazzo &* (It) – Blanche Bourdier (Fr) – Franck Berthoux (Fr) – Nicole Pronnier (Fr) – Jean-Christophe Belleveaux * – Marie-Claude San Juan (Fr) – Pierre Perrin (Fr) – François Coudray (Fr) – Adelin Donnay* (Belgique) – Sidney Simonneau (Fr) – Alain Helissen (poète transfrontalier) – Catherine Pont-Humbert (Fr) – Sophie Braganti (Fr) – Mariam Radwan (Egypte-Hauts-de-France) – Christophe Sanchez (Fr) – Joël-Claude Meffre (Fr) – Diogo Maia (Portugal-Fr) – Yin Xiaoyuan (Chine) – Anne Barbusse (Fr) – Christine de Bauw (Belgique) – Marianne Skorpis Rimo (Fr) – Eric Poindron (Fr) – Dominique Ottavi (Fr-Corse) – Gabriel Fabre*(Fr)
.
Clôtures maasai – narok kenya 2022
.
Gabriel Fabre
.
.
F
Frontière,
LA Frontière, LES Frontières, CETTE Frontière, L’AUTRE Frontière, LA DERNIERE Frontière… ad lib…
Tu sais que la vie, c’est ton cœur à nu, beau, que tu confies aux oiseaux des rues. Il pleure dans ses mains, où l’amitié le retient, embrouillamini de tentacules et d’offrandes de luxe, puisque le noir jamais ne sera une couleur. Poreuse, de toute éternité, est la F. On sable la route, immanquablement neigeuse, puisque c’est dans sa nature et que le noir n’est pas une couleur. Soulages est mort, l’alouette n’est pas
rentrée, le noir n’est pas une couleur. Mon corps est le vêtement d’emprunt qui jamais ne se plaint, ne regrette, ni ne geint, courant à bride abattue vers ce magnifique destin : le noir n’est pas une couleur… je me frotte aux F, qui me le rendent bien, soldats de Napoléon de l’enfance : le premier qui tombe fait tomber tous les autres, mais quand ? Le domino de tête, s’il tombe… ! F, trait pour trait, d’union horizontale, de désunion verticale… Le noir, ni le blanc, ne sauraient être une couleur. Sans tergiverser plus avant, délaissant les marges de mes cahiers, j’écris à pleine page ce que je te dois, que
tu ne devrais jamais savoir. J’habite en haut de l’escalier du 55 rue de la Montagne. Je te laisse la clé chez la concierge et je t’attends, patient, calme à jamais, au détour de ma phrase. Les saules pleureurs pleurent dans la pénombre de toi. Le boa constrictor, contrit, contre-attaque avec sagesse : si je ne peux admirer, je retourne à mon panier.
(…)
lire la suite ici :
Dominique Ottavi
.
.
Le silence est bleu comme un mystère avec vue sur le fleuve.
Ainsi ami, apprendre à lire le paysage ne détruit le paysage. Il faut aussi apprendre à regarder pour rien ; et regarder le paysage comme une succession de strates ne tue pas le vivant.
Souviens-toi des coteaux de Moselle et de brume et célèbre les fleuves cimmériens des Atlas de naguère.
Tu vois, amie, si tu écris quelque chose, il faut raconter les à-côtés. Les navires à la rouille cyrillique, le kiosque à musique de guingois et les robes à la dérobée des danseuses de cirque romanesque et leurs déhanchements de bagatelle.
Tu les vois amis, ami, les fantômes du Brésil qui descendent des européens et qui voient le monde d’un balcon rouillé d’autrefois ; et qui penchent sur l’océan des désespoirs heureux et des songes d’opéra au coeur des nuits et des jungles.
Souviens toi de ses eaux de Moselle, rivière bénie qui coule dans tes veines de l’Est, tumultueuse comme l’enfance.
Alors tout est en place dans ton baluchon.
On ne gagne pas ces galons parce qu’on découvre quelque chose de sensationnel.
Tout est déjà écrit ; il faut seulement trouver une petite place.
Et la juste note d’un regard ou d’une main qui se cambre et prend la pose.
Fabuler afin de mieux cartographier les jadis sous la leçon des vents.
.
Eric Poindron
.
.
.
Hors du temps et de l’espace
.
Nous sommes cinq dans ce minibus – du moins je le crois. Nous partons à trois heures de l’après-midi, même s’il pourrait être n’importe quelle heure – à la fin de l’automne, il fait déjà nuit dans cette ville du nord de la Norvège.
Passage de la frontière norvégienne, puis de la frontière russe – rien à signaler. Des hommes portent des chapkas, et mon esprit me dit : ça y est, nous sommes en Russie.
Nous avons passé le poste-frontière, et cela veut dire : géographiquement, matériellement nous sommes en Russie.
Nous sommes en Russie, et cela veut dire : nous ne sommes plus en Europe. Une frontière en théorie immense, de ces frontières qui sont peut-être plus que des frontières.
Pourtant, je suis la même. Je suis toujours dans ce minibus, aux côtés d’étrangers.
J’ai vu la frontière, oui, j’ai vu les douaniers, oui, mais je n’ai pas encore ressenti, je n’ai pas encore passé la frontière.
***
Dehors, toute lumière a disparu. Dans les vitres du minibus : du noir. Aucune indication, aucun jalon. Je vais d’un point à un autre, j’ai même le nom de ma destination – Mourmansk – mais c’est une abstraction. Je vais dans cette ville, oui, mais à cet instant cela ne veut rien dire.
Mon téléphone passe à l’heure russe. Nous ne sommes plus en milieu d’après-midi mais en début de soirée. Ce changement détruit mes derniers repères.
Pendant plusieurs heures nous avançons dans le noir – même si parler d’heures, les compter, n’a ici aucun sens. Je ne suis plus qu’un corps en mouvement dans une longue nuit. Je suis hors du temps et de l’espace.
Je ne suis plus quelque part, je suis entre. Entre deux pays, entre deux aires, entre deux continents. Entre moi et moi, dans une région de mon esprit dont je ne savais pas l’existence.
Personne ne me connaît dans ce minibus. Je n’existe qu’en tant qu’étrangère et peut-être que pendant ce trajet je deviendrai étrangère à moi-même.
***
Cette nuit sans fin finira par abriter des lumières. Des lumières, l’éclat d’une ville et l’arrivée.
Une fois arrivée, une fois allongée dans un lit, il me faudra du temps pour admettre que je suis bel et bien en Russie. Et une fois que je l’aurai reconnu, il me faudra du temps pour revenir.
***
Je n’ai pas fini de passer cette frontière.
.
Marianne Skorpis Rimo
.
.
Comment partir en Palestine ?
.
La Palestine, ça n’existe pas… Il y a le « pays de Jésus » de l’enfance, couleur sable et tuniques d’apôtres sur du papier glacé. Ou celui, admettons, de Lawrence d’Arabie : chemin de fer du Hedjaz, dunes infinies du Wadi Rum, Pétra. Partir en Palestine, ça ne fait pas sérieux.
Israël, je connais. Ça existe. Mais la Palestine ?
C’est difficile, de partir dans les mots.
.
____
.
Au jardin du carrier, les pages de pierre somnolent, en repos sur la tranche, dans le murmure égal du soleil : qui viendra ? On vend au plus offrant. Si l’occupant achète, marché conclu : on fournit aussi la main-d’œuvre.
Dans l’herbe sèche, le chant des dalles bascule, effleure un instant la diagonale. L’ouvrier les emporte : épousailles de l’espace.
Horizontal/vertical. Il faudra décider : ou l’un, ou l’autre.
Etendre comme un drap la dalle des tombeaux : caressés par le ciel, ils boivent par myriades la lumière.
Cabrer dans son aplomb la pierre aux aguets, verticale, coupure du bleu : des habitations par milliers, des banques, des stations d’essence.
Entre les deux, la route, qui relie ou qui désunit. Et l’un, et l’autre.
Enchevêtrés : tombes, maisons ; arabe, hébreu ; échelle, taxi ; permis bleu, permis vert ; hier, demain ; autorisé, interdit. Mitraillette, goyave. Plaques jaunes, plaques vertes, oliviers bleus, pierres en plein vol, amas de pierre, béton du mur.
Horizontal/vertical. Il suffit de voir.
Le cardo fuse et tout l’espace s’ouvre en étoile. Le jet d’un minaret inverse l’horizon.
La mer étale écrit ses vagues de droite à gauche et mugit les textes sacrés, chavire brusquement, arbre effilé, et va trouer le ciel.
Horizontal/vertical. A la croisée du grillage, avant le tourniquet d’acier, un enfant sanglote dans les bras de sa mère, au terminal de Gilo, le matin.
.
____
texte complet à lire ici :
Christine De Bauw
.
.
suspendue la frontière1
.
.
suspendue la frontière entre brume et hiver dans un no man’s land boueux/neigeux
suspendu le pas du douanier telle une cigogne
sur le pont suspendue la ligne bleue méticuleuse ou énigmatique
entre Albanie et Grèce des vies suspendues et migrantes dans un travelling sur
les wagons échoués (comme une Shoah qui nous accuse) où des visages de familles fixes regardent
la caméra du documentariste de télé, rectiligne et parfaite, effleurant
les groupes d’enfants femmes épaves débris
et le filmeur s’expulse du film projeté vu et revu
où quête l’après-visage du monde
en salle obscure dans la ville-salle d’attente
(tout ce que je savais c’est filmer les autres sans me soucier de leur sentiment, recette télévisuelle éculée)
suspendu le pont des non-retrouvailles entre une Jeanne Moreau et un Mastroianni étrangers
(comment un homme devient migrant volontaire comment un Italien se fait Grec qui se fait Albanais) se désavouant sous le cadrage séparant couples et visages
perchistes invisibilisés
suspendu le mariage entre deux rives d’un même fleuve, silence spectral, gestes
hiératiques d’un pope inutile, figurants vêtus d’un noir hivernal, non-communication violentée par obstacle
la frontière est un fleuve expulsé de lui-même (un Evros aussi), qu’on
franchit hors champ, une distance
de soi à soi (si je fais un pas je suis ailleurs/ou je meurs)
Puis des hommes vêtus de combinaisons jaunes
(comme des soleils estropiés)
montent très lentement
avec musique et par-dessus la neige
se suspendent aux poteaux téléphoniques
rétablissent communication et voix lointaines
humaines et figées, cinéma arrêté, nature morte
comme de grands échassiers aux pieds de bois
rafistolant les lignes outre-frontières
chorégraphie de crucifiés
ne rien posséder hormis son corps
migrer parle mythique
caméra enregistreuse de paroles/discours/récits
le douanier alors se dit personnage de tragédie
le Grec-Albanais passe le fleuve sans obole
après avoir écrit Mélancolie de fin de siècle ou
de début de millénaire
suspendu le film à la frontière du filmable, hors pas
.
____________
1 – A propos du film Le pas suspendu de la cigogne, Theo Angelopoulos, 1991
.
Anne Barbusse
.
.
.
Limites de collision
.
Des plumes d’oie flottaient encore à l’horizon crépusculaire. Un cauri était posé près de l’oreiller – un symbole pour rappeler l’histoire de la monnaie. Le banc de maquereaux grouillant sur le panneau LED du plafond témoignait que tout se dépixélisait : la ligne d’écriture « la disparition de l’océan Téthys et l’éclatement du Gondwanaland » avait déjà été déplacée sous « acrylique et graphite sur toile »
Le danseur costumé en momie racontait en langue des signes le passages des « récifs frangeants » aux « récifs barrières » puis aux « atolls »: au cours de toutes les variations de la Nature, des lagons sont apparus et la biocénose a prospéré. A 3m46s, des fils coraliens ont fouetté le givre du fond marin, puis à 8m5s un éolide d’un rose vif a cassé les tentacules d’une anémone de mer et avalé ses nématocystes…
Une feuille blanche a été levée en silence comme dans une vente aux enchères, protestant contre la mort dans le film du Gardien aux cheveux gris: c’était un vieux schnock, jouant d’un violon couvert de toiles d’araignée tout en surveillant la zone des frontières en construction. C’était la partie nord en surbrillance de Chagos-Laccadive Ridge : verte comme la poudre de moringa, orange comme la confiture. Son nom était Maldives
Un rideau hallucinogène flottait au-dessus du banquet, où l’on pouvait voir dériver la trajectoire de tous les plats du monde scintillants comme un feu d’artifice : des raies ressemblaient à des cymbales crash, des murènes avaient l’air de cornemuses, des poissons-chirurgiens d’un bleu cendré tissaient des océans de fleurs
« ‘Le Pêcheur’ – c’est son nom. Ce n’est pas un titre héréditaire. En fait, chacun est nommé par son prédécesseur, choisi parmi la foule des touristes. »
Le Gardien de la dorsale médio-atlantique était un barbu aux cheveux frisés, tenant dans ses bras un instrument de musique rond, le « Segulharpa », à touches électromagnétiques, inventé par Úlfur Hansson, doté d’une cardioïde. Juste avant, il avait les mains vides
Dans les plans en rafale avec son crocodile favori, il avait l’air plutôt nordique, et le manque de communication entre les deux rôles principaux était évident. Les gens discutaient pour savoir s’il s’agissait d’un vrai crocodile ou d’une longue racine d’arbre s’étendant du sud de l’Afrique à l’océan Arctique, crachant une énorme flamme appelée « Islande ». Cette scène était suivie de vagues de lait concentré sur la Black Beach, ou sur l’Öxarárfoss gouaché de bleu – cela dépendait des algorithmes inactifs
Sans le déplacement en cascade de ces franges d’aurores boréales, le public aurait protesté contre toute l’intrigue : dans l’interface VR, la voiture qu’ils « conduisaient » traversait la nature sauvage, suivant une route aussi fine qu’un brin de soie grège : les ombres en dentelle de Chantilly bruissaient sur l’écran de projection
Dans un gros plan en noir et blanc, la fillette tenait dans ses mains un gros morceau de glace : un cristal non serti sur fond de velours noir. Un faucon gerfaut blanc se posa sur le Lögberg, puis disparut comme une tempête de flocons de neige dans le brouillard et des icebergs de coton
« Les limites constructives sont généralement un spectre de verts, et non une nouvelle chair rose. Le modèle idéal en est le «nombril» étroit entre la plaque nubienne et la plaque arabe. La Mer Rouge sera la base d’un tout nouvel océan, juste à côté de la vallée du Grand Rift est-africain, sous le mont Kilimandjaro
[La séparation de la mer Rouge] – les détails n’étaient pas mentionnés dans les intermèdes, mais les météorologues décidèrent de l’appeler un « wind setdown». Les capteurs étaient partout, prêts à projeter la volonté humaine dans l’espace lointain
Les limites de collision suggéraient que les bords de la terre se déformaient vers le haut et s’étendaient verticalement. Ils n’avaient jamais été « repliés ». Le Gardien de l’Altiplano était enveloppé dans son manteau comme un cocon. Il aimait le Pain de campagne[i]qui avait lui aussi des fissures rugueuses en surface
Pendant qu’il s’amusait, des éclairs au-dessus du lac de Maracaibo furent emballés et mis en vente, des bateaux de roseaux du le lac Titicaca levèrent leur tête de puma et se précipitèrent vers l’ île flottante d’Uros, et dans Salar de Uyuni – des empilements de sel devinrent des pièces d’échiquier
À chaque coucher de soleil, il y avait des traces de rennes et de renards dorés. Comme si soudainement dans le monde devenu désert, des fragments de lumière tourbillonnaient au cœur d’un mirage géant
Les archéologues continuaient de creuser. Des geysers, des trous comme des brûlures de cigarettes sur la terre, les avertirent d’éviter Coricancha. Pas de soucis, la zone de subduction tomberait dans l’oubli avec tout le suspense
[i] en français dans le texte
.
Yin Xiaoyuan – trad. Marilyne Bertoncini
(depuis la version anglaise de l’autrice)
.
versions originales anglais/chinois ici :
.
.
Passer et chanter à gué
.
Je suis arrivée à A Coruña l’après-midi du 7 avril 2022, venu de Porto. Un petit quiproquo linguistique a marqué ma deuxième rencontre avec Xulio[1], poète galicien très doux et précis. Cette fois-ci, on n’allait pas faire un entretien comme la dernière fois, et donc il n’y aurait pas de caméras ou de micro entre nous. On ne serait que tous les deux en promenade le long de ce bout de terre entouré d’océan. J’avais visité A Coruña, La Corogne, pour la première fois, à l’âge de six ans avec mes parents.
Au téléphone, j’avais dit à Xulio : « Chego à 16h à Rodoviária[2] », mais Xúlio s’est rendu à la la gare de trains qui ne se trouve pas très loin. Il n’avait pas compris le mot portugais «rodoviária», qui n’existe pas dans la langue galicienne, ayant compris, à la place, le mot «ferroviaria», un paronyme.
Quelquefois, le galicien et le portugais divergent et cela provoque des situations quelque peu compliquées et drôles. Il faut que vous sachiez que ces deux langues ont partagé le même chemin au Moyen-âge : elles ont constitué une seule langue – le galaïco-portugais, langue des troubadours ibériques. Aujourd’hui, leur proximité, quelque fois apparente, nous fait plonger dans une douce confusion qui semble éloigner et rapprocher les gens des deux rives. C’est un mouvement historique qui s’empare de nous ; un mouvement à la fois de ressemblance et dissemblance linguistique et culturelle. J’ajouterais même que cette confusion semble être diluée dans le fleuve-frontière qu’on traverse – le Minho ou le Miño. C’est peut-être dans l’eau !
Quant aux gens – qu’ils soient portugais ou galiciens – ils ne cessent pas de le passer à gué grâce à leurs parlers, à leurs unions culturelles et amoureuses. Ils contredisent la séparation. Ils savent que c’est une affaire d’attirance, car on est, ici, sous l’effet d’un filtre ancien et très puissant !
(…)
lire la suite ici :
[1] Xulio López Valcarcél (Lugo, 1953)
[2] « Gare routière »
Diogo Maia
.
.
La Frontière de la Malédiction : le mur de la Peste
.
.
Le marcheur chemine sur le sentier qui borde le mur-frontière « de la malédiction » dressé par les communautés pour se préserver de la pestilence. Il a été reconstruit sur plusieurs kilomètres. C’est donc d’un pas silencieux et concentré qu’il progresse le long de l’ouvrage à partir de son point de départ dans le creux du vallon de Bourbourin, à l’est de Cabrières. Le marcheur avance dans la sérénité du versant au milieu des bois de pins et d’yeuses mêlés d’épineux, de cistes chamarrés, et d’amélanchiers aux fleurs étoilées. Au passage, il replace sur le sommet du mur quelques pierres instables prêtes à basculer. Le rocher de calcaire gris sur lequel le mur s’appuie et par où se profile le sentier est lustré, poli par les pas des marcheurs ; il est comme un miroir des foulées ancestrales. Dans sa lente avancée il imagine avec quel empressement, quelle hâte, les communautés villageoises de Lagnes, Murs, Venasque, emportées dans la tourmente du temps, ont dû fébrilement organiser la mise en œuvre de cette barrière de pierres sur la frontière entre le Comtat Venaissin et le Royaume de France pour faire front à la mort ravageuse. (…) (1)
_______
(1) – les témoignages censés avoir été écrits au XVIIIème, sont entièrement de ma main et issus de mon imagination. Ils ont été écrits dans le style parlé du XVIIIème s.
Joël-Claude Meffre
.
lire la suite ici :
.
.
.
.
Il fait un jour à faire sauter les frontières.
On pose des barrières sans s’en rendre compte. Même si elles ne sont que voiles, elles n’en sont pas moins frontières. Frontières que sont nos manières de se vêtir ou se dévêtir, de parler, de rire, de pleurer, de s’aimer, de voir et d’entrevoir. Barrière que c’est d’être. Le monde et nous à distance. Heureusement, il y a toujours ton regard qui m’approche.
Il fait un jour à faire sauter les frontières.
__
Il fait un jour à tenir le paysage debout.
On doute de notre regard. Des îlots de réalité qui le composent. Les points et les lignes qui tiennent le tout ensemble ont des tremblements. Petit séisme dans l’appréhension de ce qui se dresse devant nous. Il faut retenir nos langues qui auraient vite fait d’expliquer les petites erreurs du réel. Il y a trop peu d’arbres qui traversent la ville pour nous rassurer. Rien que ce trou sur le trottoir ne présage rien de bon.
Il fait un jour à tenir le paysage debout.
__
Il fait un jour à renverser le ciel.
Un silence inhabituel habite nos pas comme si l’on marchait sur une vieille neige. Rien ne nous affole. Pourtant nos pieds foulent les nuages. Oubliés horizon et lignes de fuite. Nos mémoires suivent les bottes. Un soupçon d’ivresse dans le vide de nos regards.
Il fait un jour à renverser le ciel.
__
Il fait un jour à chasser le Dahu.
Prenons nos rêves pour des bêtes sauvages. L’imaginaire comme seul poids sur nos ailes. À flanc de montagne, allongeons les chimères. Moquons-nous de la peur qui se dresse. Chatouillons nos angoisses pour rejoindre l’animal dans ton regard, celui que l’on n’a jamais pu capturer.
Il fait un jour à chasser le Dahu.
.
Christophe Sanchez
.
.

Carte imaginaire région hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais x Le Caire
Broderie sur tissu 50×70 cm- 2021- Mariam Radwan
Les gens du Nord, Le Nord du cœur
Ah Ça » C’est comme chez nous dans le nord« ,
Cette phrase me tape très fort.
Je viens du nord, mais je viens du Caire.
Mais oui quand même, j’ai vécu 3 ans dans le nord.
Mes 3 ans après ma trentaine…
Je suis venue à 30 ans
Je suis devenue 30 +3
J’ai grandi
J’ai vécu
J’évolue
Les 3 ans après mes trente,
Voilà! Maintenant, J’ai les 3 ans du nord,
J’ai 3 ans en plus du Caire.
Et j’ai mon bac +5 du nord.
Eh oui, J’ai 33 ans!
C’est au même âge qu’on sera envoyé tous au paradis.
C’est la crème de la crème de la jeunesse et de l’humanité.
11.11.22
Belfast
.
.
Beyrouth
.
Ville de contrastes, de paradoxes, de limites sans cesse repoussées, de malédictions affrontées, de reconstructions amoncelées, Beyrouth accumule les paradoxes, les superlatifs.
Je m’y perds, je ne la comprends pas toujours mais je l’aime.
Elle provoque en moi un tremblement, quelque chose qui me dépasse et m’enchante. J’accepte de glisser dans ce quelque chose que je ne sais pas définir, qui a trait sans doute à l’émerveillement.
Beyrouth repousse toutes les frontières et m’oblige à repousser les miennes.
Je la retrouve après dix ans d’absence, renouant avec des lumières, des ambiances, des sons, des odeurs qui me relient immédiatement à celle que j’étais dix ans auparavant.
Aux fenêtres des immeubles, je revois, comme des jupes qui filtrent la lumière, la cascade des rideaux flottant au vent.
Les immeubles serrés les uns contre les autres forment un grillage qui semble accroché à la montagne, juste derrière. Au milieu de cet empilement urbain, sur les murs lépreux, le regard est accroché par les blessures des immeubles, façades crevées, pignons mutilés. Et puis soudain, au milieu de ce chaos de bâtisses anciennes qui portent toutes les mémoires, la tour fuselée d’un immeuble rutilant affiche sa façade postmoderne.
L’architecture de Beyrouth me fait penser à un besoin irrépressible de combler les trous
Je suis à nouveau frappée par cette absence de jardins que la nature refoulée par le béton ne cesse de contester. Partout les arbres font exploser le goudron ; des troncs tordus par l’effort percent sa carapace ; le bitume crevé halète sous le soleil ardent ; une végétation grise de poussière s’impose, asphyxiée par les gaz des pots d’échappement.
A Beyrouth désormais les lumières naissent presque exclusivement des générateurs dont chaque édifice a la charge. Les néons multicolores jettent leur lumière crue sur les trottoirs défoncés et le passant zigzague entre les obstacles qui ne cessent de s’accumuler sur son chemin.
La discontinuité des trottoirs oblige bientôt à héler un taxi tant marcher dans la ville relève de l’exploit. Le trafic repose sur une anarchie régulée par le seul rapport de force, l’intimidation, et quelques défis.
Pas plus que de promenade dans un jardin, il n’y a de baignade possible dans la Méditerranée qui offre pourtant ses beautés sur la Corniche. Personne ne se baigne à Beyrouth. L’eau omniprésente est atrocement polluée.
Derrière les strass, derrière les voix envoutantes qui enroulent les langues mêlées, on voit couler la lassitude dans les regards. Dans les cafés, les notes d’orient butent sur le désespoir.
Aux terrasses, un anglais écorché, un français roulant ses consonnes et un arabe chantant s’entremêlent pour dire le mal de ce pays blessé.
L’identité de chacun est sans cesse déclinée, pas d’autre choix que d’appartenir à un clan.
Les échanges sont empreints de violence. Comment pourrait-il en être autrement face à tant de malversations et face à une corruption que sa dénonciation ne freine nullement.
Rajoutant à une guerre civile de quinze ans, l’effroyable cupidité, l’égoïsme, la gabegie se sont associés pour rendre possible l’explosion du port par l’entassement de produits dangereux sans protection, en l ’absence de toute précaution.
Mais déjà la ville et ses immeubles soufflés semblent avoir tourné la page.
Cette faculté de reconstruction exceptionnelle soulignée par tous produit aussi un effacement de la mémoire. On rebâtit pour mieux poursuivre un élan qui permet d’aller vers l’avant, élan que l’on peut aussi interpréter comme un refus de regarder derrière soi.
On comprend combien il est facile de fuir quand la répétition des tragédies est si intense.
Le Liban reste un rêve constamment empêché. Le rêve d’une coexistence possible entre communautés qu’unirait en dépit de tout un fol appétit de vivre et cette aspiration toujours vitale à la culture.
On raconte que sur un tombeau découvert à Byblos, le premier mot de l’écriture moderne gravé 10 000 ans av. JC est malédiction.
.
Catherine Pont-Humbert
.
.
Du poète transfrontalier
Un vers d’un poème transfrontalier peut parfaitement avoir la tête en Allemagne et les pieds en France ou vice-versa oder das Gegenteil.
Un poète qui se présenterait au concours des poètes transfrontaliers sans son passeport ne serait pas admis à concourir.
Le poète transfrontalier peut bénéficier d’aides étrangères mais cela ne s’est encore jamais produit.
Les poètes transfrontaliers des différents pays de la communauté européenne qui n’étaient pas, jusqu’ici, payés en différentes devises des différents pays de la communauté européenne ne seront pas différemment payés en euros.
Un poète transfrontalier qui ne passerait pas de frontière au moins une fois par mois perdrait son statut de poète transfrontalier pour retrouver sa condition de poète provincial sédentaire.
Un poète transfrontalier n’est autorisé à franchir que les frontières qui entourent son pays d’origine. S’il voyage au-delà il peut prétendre au statut de poète international ou même à celui de poète trans-continental.
S’il n’a rien à déclamer, le poète transfrontalier est considéré comme un touriste standard.
S’il ne produit pas de nouveaux poèmes au moins tous les cinq ans, le poète transfrontalier doit repasser sa LPF (licence poétique transfrontalière).
Malgré toute l’estime qu’on peut lui porter, Jésus n’était pas un poète transfrontalier.
À chacun de ses déplacements, un poète transfrontalier ne peut pas exporter plus de dix poèmes de sa composition. Tout excédent sera confisqué à la frontière pour figurer dans l’anthologie annuelle : Poèmes sans frontières.
Un poète transfrontalier qui laisserait apparaître des sentiments nationalistes peut être confisqué par les douaniers et son auteur refoulé à la frontière.
C’est dire que le poète transfrontalier doit s’abstenir de tout esprit de propagande.
.
Alain Helissen, poète transfrontalier.
.
.
Frontière mentale
.
Les contours friables de sa mémoire se dissolvent dans cette caricature de conscience qui l’habite désormais. L’enfance se rapproche, en apparence. D’anciennes lueurs vacillent toujours au fond de son crâne, des instants de grâce, des taches flamboyantes laissées par sa vie au gré du chemin …
Je ne sais plus les mots qui soulagent.
Sur le tarmac de ses songes, où s’accumulent les traces de ce qui l’a construit, s’élabore lentement un compost particulier. Celui de l’effacement. Et des métamorphoses mentales. Nulle limite, en apparence, ne saurait contrarier la fuite en avant vers cette autre logique, vers cet envers désiré, vers ces simulacres de transes. Car le glissement a opéré. Les feuilles noircies de certitude ont fini par tomber. Les unes après les autres. Sans bruit ni regret. L’automne d’une conscience n’a jamais besoin de témoin. Seul les grands vents en escortent les dernières pensées. Jusqu’aux frontières frissonnantes du réel, là où la normalité pose un genou à terre et fixe l’inconnu. Pour lui lancer un ultime défi.
J’ai oublié la grammaire archaïque que m’enseignait jadis la lumière.
Les contours de son esprit se lézardent. Ils ne tiendront plus longtemps. De nouvelles barrières se présentent qui en perturbent la respiration. De nouvelles bornes font écho à son histoire, à sa présence. Sa lucidité s’arc-boute, comme elle peut, mais sa raison cède de la place, inexorablement.
J’ai froid d’un seul coup. Ma langue, privée d’écho, tremble.
La frontière capricieuse se cherche une voie. Elle tâtonne, elle fouine, elle se risque jusque dans les ultimes méandres de cette forge, jusque dans les recoins les plus cachés de l’encéphale. Sa détermination est totale. Comme l’est le vertige qu’elle suscite. C’est qu’elle le sait : son tracé, par les connexions qu’il établira, précipitera inexorablement cette âme dans la folie.
Je me délaye maintenant dans cet espace profane, hors de toute limite et presque étranger à mon propre corps. Je m’extrais de ce qui fut moi pour franchir les lignes et parvenir enfin aux confins des choses.
Demain n’existe déjà plus …
.
Sidney Simonneau
.
.
.
À force de les passer c’est en moi que les frontières se sont déplacées. Il est, partout, des terres où réinventer le jardin et des frères* de la même enfance. Mais il y a aussi cela qui résiste à trouver place, à être accueilli. Lent travail alors, en profondeur, pour ouvrir (le clos, le rassurant, le fort intérieur), redescendre, au plus bas écouter (souffle contre souffle, pulsations à contre temps), accepter d’en être, peut-être, changés (se perdre ? perdre ? recomposer la géographie de l’eden, forts de cela qui a creusé en nous un espace où être moins à l’étroit**).
Et le tissage de nos langues pour cultiver ce vert nouveau.
Sans doute cela n’est-il pas assez, mais il est des instants où mon poème voudrait croire qu’ainsi un jour finiront par tomber les frontières du-dehors.
.
___________________________________________________________________________
* ces frères qui sont aussi des sœurs : mes hermanos des rives du Rio de la plata, mes kardeşler des rives du Bosphore…
** da liegt man nicht eng (Paul Celan)
.
François COUDRAY, inédit
.
.
.
.
AUX FRONTIÈRES DE L’HUMANITÉ
La vertitude offre de telles sautes d’esprit que la raison déraille. L’art et les glaciers font partie des patrimoines de l’humanité. Les seconds fondent ; le premier doit disparaître. Des activistes font macérer le pauvre Van Gogh. Autant de petits Gœbels devant des chefs-d’œuvres !
.
La Bible atteste un déluge, voilà six ou sept mille ans. Nos inondations les plus meurtrières n’appellent aucune Arche de Noë. Au Moyen Âge, l’Europe a connu les pires froids. Des famines se sont ensuivies. On l’oublie. « Nous avons ici des 40 et 45 degrés de chaleur à l’ombre. » Lettre de George Sand à Flaubert, de Nohant, 26 juillet 1870. Un changement climatique a cours.
.
Aux angoisses de la jeunesse, attisées de partout, que répondre ? Tant de pauvres exigent le consumérisme, quitte à périr en mer. Les boucs émissaires évitent de penser. Énergies fossiles, industrialisation, mondialisation, tourisme, libéralisme, capitalisme, terminé ! D’urgence décroître. Toilettes sèches, cueillette, tous au pithécanthrope ! Supprimés l’avion, les aéroports ; les trente-huit tonnes, les autoroutes [les bicyclettes ont besoin d’huile pour la chaîne] ; les cargos, les mers, la Chine, l’Inde et les USA ; les villes et les rurbains car, la chasse, l’élevage, la viande, les laitages interdits, les déplacements réduits à croupetons, l’herbe pousse mal le goudron, le béton. Le salaire universel enfin prélevé sur quels survivants, la misère ravira-t-elle le vertotalitaris qui dansera dans
les cavernes ?
.
Je caricature, mais si on ouvrait les yeux. Avec la Covid, en 2019, en trois semaines, le ciel de Pékin était redevenu clair, un village. Que reste-t-il de la sécheresse de l’été, en France ? Les prés sont verts, d’une insolence rare, les vaches pâturent et les arbres perdent à peine leurs feuilles, la Toussaint passée. Un peu de mesure serait bienvenue. Combien de giga-octets chargés sur les serveurs de Fb ? Ces serveurs ne sont-ils alimentés que par des éoliennes ou des esclaves à pédale ? Et pourquoi les grands messes, de type Cop, ignorent-elles tout de la visio-conférence ? Marchons
sur la tête. La terre en sera moins marquée.
.
Pierre Perrin, novembre 2022
.
.
Qui écrit habite des frontières…
Je m’en vais d’où je viens
Et je viens d’où je suis
Paul Valet « La Parole qui me porte »
.
Née près d’une frontière, ayant vécu sur une autre, et traversé la troisième pour aboutir où je suis, c’est un sujet qui me concerne, vital, intime. C’est peut-être pour cela que je pense la frontière comme un concept fondateur. Pas un mur, mais un bord, un tissage, un réseau de sens, une ouverture. Quand on est au bord on saisit un double espace, on est traversé par ce qu’on traverse, riche de l’avant et de l’après.
.
Et quand on écrit, si on cherche l’authenticité à la racine de notre parole c’est cela qu’il faut retrouver, en prenant le risque de la perte. Accepter d’habiter comme une absence de lieu, fréquenter intérieurement à la fois la force du silence de ce qui s’efface et l’excès du bruissement de ce qui veut être dit. Double flux. Peut-être imprégné de cette inquiétante étrangeté pensée par Freud. Affronter cela et vivre l’expérience d’écrire comme une sorte d’état-limite qui frôle de possibles abîmes. L’essentiel justement. Comme le dit encore Paul Valet (Que pourrais-je vous donner / De plus grand que mon gouffre)… Et malgré cela garder repère de rationalité.
.
Écrire en étant à la fois le JE (celui des émotions, de la conscience du corps, de la mémoire et de l’oubli) et le IL-ELLE de la distance d’avec soi-même, pour savoir entrer dans le processus de dissolution de l’excès d’ego.
.
Ne pas avoir peur que l’imaginaire délire un peu, accepter les fantasmagories du rêve, et plonger dans ce qui, au bout du réel le plus réel, peut rencontrer des gouffres.
.
Là est l’enjeu.
.
Rester sur la ligne de la frontière, sans basculer, mais en saisir la force.
.
Écrire en travaillant mentalement et esthétiquement sur les fissures, les failles, la langue sous la langue.
.
On glisse d’un lieu intérieur à un autre lieu intérieur, marchant, en acrobate somnambule, sur le fil mental qui les sépare. Le geste d’écrire est différé en permanence, entre le temps de la maturation et la trace sur le papier puis la frappe sur le clavier. Cet espace de temps est celui du risque. Errance intime entre le rien d’une absence et la matière du sens inscrit.
.
À la frontière, donc.
.
Au bord de l’inconnu.
.
Celui qui écrit, celle qui trace, est un humain, ancré, les pieds sur terre. Mais à la conscience voyageuse cosmique. Poussières d’étoiles, rappellent Hubert Reeves et Trinh Xuan Thuan (qui, dans Le Cosmos et le Lotus, écrit que savoir cette identité stellaire déferait le mur qui nous sépare d’autrui). Et voilà encore ce qu’écrire doit tenter. Tout en abordant les limites, ces frontières que l’inconscient sait, défaire les fausses frontières. Alors on pourra pénétrer en conscience les stratifications du langage, sa matière sonore et graphique, comme pour une chirurgie textuelle permettant d’aller au-delà du sens commun, et accepter de frotter notre rationalité à d’autres rationalités. Lisant le monde et le cosmos comme un texte à déchiffrer, un réel à regarder avec des yeux derrière les yeux, frontière à franchir, encore, subversion de soi à soi.
.
D’un côté la genèse infinie, de l’autre l’inachèvement perpétuel. À la frontière, des traces et rien d’autre, donc le livre. Une interminable expérience de la perte, constitutive de l’écriture comme expérience des limites de ce que peut la conscience. Jeu entre la pensée, l’impensé, le non-savoir, l’incertain. Hésitation entre l’état du saint, du sage, ou du fou. Aux bords de l’absolu. Radicalité qui élimine ce qui serait en-deçà d’un certain risque assumé, celui de mettre en jeu tout l’être.
.
La conscience de qui écrit devient la zone frontière entre deux sortes d’univers mentaux et perceptifs. Celui d’une langue des concepts communs, celui d’infra-concepts, les franges, les marges. Et c’est au bord du vide que produit la pensée avant d’être pensée qu’est sollicitée l’énergie psychique et physique pour provoquer des ouvertures où se glisser. Pour que le sens ne soit pas clos. Comme une scission à l’interface (cerveau, esprit) d’une sorte d’intertextualité primordiale, dans une marge souterraine de la conscience.
.
Dans l’acceptation de cette béance ouverte il faut se mettre en état d’aphasie pour pouvoir parler, d’amnésie pour qu’une autre mémoire intervienne et procède à la stimulation d’un nouveau processus combinatoire. Être entre une désappropriation du langage et une recréation privée, celle des interférences possibles entre des espaces séparés. Habiter l’autre de la langue, celui qu’on crée. Vivre un écart, un inconfort, un bilinguisme d’une seule langue, pour interroger les strates les plus obscures, celles de l’insu de soi et de tous. Pour une archéologie qui fait advenir ce qu’un seul peut mettre en mots, en passeur de frontières.
.
Pas d’écriture sans risque. La seule qui vaille. Mais qui déchiffre son texte intérieur ne bascule pas dans l’impossibilité de nommer et tracer. Il reste au bord, en veilleur.
.
Val del Omar (grand poète et cinéaste visionnaire espagnol) le dit, ce risque. Lui qui écrivit que « l’authentique communication poétique humaine naît de »… quien afrontó el peligro yendo con su experiencia hasta la frontera del misterio. (Qui affronta le danger en portant son expérience jusqu’à la frontière du mystère).
.
Marie-Claude San Juan
.
.
.
.
À la frontière du jardin
De cette histoire racontée par ma famille, je n’ai personnellement que peu de souvenir car je n’étais encore qu’un bébé d’à peine deux ans.
De l’autre côté du jardin, c’était l’inconnu. Des soldats avaient réquisitionné le logement qui faisait face au nôtre. J’étais à l’âge où l’on s’amuse d’un rien, jouant à courir avec mon frère et ma sœur, riant de leurs facéties. De l’autre côté du grillage, un monsieur en vert me souriait tout en racontant son histoire à mes parents : « C’est grand malheur, la guerre ! ». Il leur parlait de sa petite fille qu’il avait laissée en Bavière et qui ne le reconnaîtrait peut-être pas à son retour. Si un jour il rentrait en Allemagne…
Il avait rejeté bien loin tout ce qui nous séparait, et, chaque jour, il m’appelait à la frontière des deux jardins : « Nicole, Komt ! » J’accourais, sous les yeux de ma mère qui n’osait montrer sa désapprobation. C’étaient quelques bonbons, une barre de chocolat que ma mère, méfiante, s’empressait de jeter à la poubelle : « du poison », disait-elle.
Pour moi, Hans était mon ami car, dans la petite enfance, on ne fait pas de différence entre les grandes personnes pourvu qu’elles soient aimables. Pour lui, j’étais une petite fille comme la sienne et non l’enfant de l’ennemi que l’on doit combattre à tout prix.
Pendant ces brefs instants de bonheur, il oubliait la guerre et son cortège de souffrances ; il ne mettait aucune limite à son dévouement envers moi et ma famille. Il y avait toujours une certaine méfiance de la part de mes parents envers l’envahisseur. Cependant, quand il a fallu quitter notre logement à cause des bombes anglaises qui détruisaient les gares et tout ce qui se trouvait alentour, constatant les hésitations de ma mère qui craignait les pillards, c’est Hans qui est venu lui promettre qu’il surveillerait la maison ; ce qu’il a fait car, quelques jours plus tard, nous avons retrouvé notre chez-nous tel que nous l’avions laissé.
Il est des frontières infranchissables qu’il faut oser franchir.
Nicole Pronnier
.
.
.
Empêché
.
– J’ai longtemps été empêché
par des frontières invisibles mais bien réelles
– Empêché de quoi
– Empêché d’être droit
d’être insouciant
de regarder les gens dans les yeux
de me donner le droit d’avoir des désirs, des envies
d’être libre et heureux
de pleurer
d’aimer la saveur de mon sang dans mes veines
et les fontaines des jardins
d’aimer l’été
de graver mon nom sur l’écorce des arbres
de croire que mes rêves pouvaient se réaliser
La révolte étouffée ne mène pas à grand-chose
Et puis, un jour, je l’ai croisée
Je ne sais ce qui s’est passé
quelques-uns de mes liens se sont défaits
et peu à peu lentement
je ne sais ni pourquoi ni comment
mes frontières invisibles
se sont délitées
dissoutes
fondues comme neige au grand soleil
Elle a été elle est la force nécessaire à ma libération
je lui suis et lui serai reconnaissant jusqu’à mon dernier jour
.
Franck Berthoux
.
.
INTERROGATION
Ce monde qui nous entoure, vaste, angoissant, chargé d’inconnu, nous cherchons à mieux le comprendre. Nous découvrons d’abord nos semblables, les humains, si nombreux, si différents qu’ils nous perturbent souvent. Nous pouvons les aimer ou les détester. Il arrive que les points de compréhension soient difficiles à saisir. Ils nous comblent de joie, par la pensée, les idées, les métiers, les activités, ou nous désespèrent. Il nous faut un temps infini pour accéder à la pleine compréhension de soi-même et des autres.
Parfois un animal assure le lien. Lui, au moins, ne nous contredit pas. Pas si sûr, l’animal possède aussi sa propre personnalité. Des heurts, des conflits peuvent se produire. Il n’est pas si facile d’assouplir l’entente entre eux et nous.
Une question se pose : nous, humains, sommes-nous déjà reliés aux animaux par nature, ou bien est-ce notre imagination qui nous relie ?
Quelles sont les frontières les plus difficiles à franchir ? Celles du cœur, celles du bon sens ? Où est la ligne rouge qui nous sépare ?
Les échecs de part et d’autre sont nombreux. Il faut recommencer, trouver un langage qui réduise les frontières, pour que cessent les haines, les colères, le mépris, la jalousie et que seul demeure cet immense besoin de paix, d’entente et d’amour auquel aspirent au fond d’eux les êtres vivants, quels qu’ils soient.
Nous les humains, nous avons de bien mauvais exemples et de bien mauvaises réponses à offrir, puisque les guerres en ce nouveau siècle se rallument de partout.
Blanche Bourdier
.
.
S-confinare1
L’idea del confine contiene in sé il suo opposto, presuppone un limite oltre il quale spingersi (invece, purtroppo, sempre più spesso, il confine diviene un luogo entro cui barricarsi). Limite e confine non sono barriere immobili. Esiste nel concetto di limite una meravigliosa ambivalenza. In latino ci sono due parole che contengono la stessa radice: limes e limen. Se il Limes latino significa demarcazione di un territorio, linea di confine (in epoca romana una postazione militare fortificata, e quindi, di rimando, una barriera tra l’esterno e l’interno), limen riporta invece al concetto di soglia, un luogo da attraversare, quindi un’apertura verso lo spazio esterno, verso l’altrove, verso ciò che non conosciamo e soprattutto verso l’altro da sé. In quanto limes, il confine divide lo spazio, separa luoghi e idee, lingue e culture, crea differenze e chiusure ma, sottolineando il concetto di limen, esso presuppone anche apertura, movimento, nuovo inizio, dialogo plurale e inclusivo: imparare a riconoscere e apprezzare le differenze, trasformandole in terreno fertile di ricerca, sperimentazione, evoluzione, legame e armonia.
Ecco e Da qualche parte ai confini del regno due poesie che denunciano i confini fisici, territoriali e personali, di chi si muraglia dietro proprietà, appartenenza ed esclusione dell’altro da sé. Nel silenzio dell’uomo racconta della vita durante il confina-mento (lockdown) nei lunghi anni sospesi del Covid. Infine, Il Bosforo dall’alto, immagina uno spazio senza alcun confine, in cui tutto può accadere.
L’immagine, Kittilä, Finlandia, con le partizioni orizzontali riprese dal vetro, racconta di un dentro e di un fuori, di spazi mentali.
Lucilla Trapazzo
.
.
L’idée de frontière contient en elle-même son contraire, elle suppose une limite à franchir (au lieu de cela, malheureusement, de plus en plus souvent, la frontière devient un lieu à l’intérieur duquel se barricader). Limite et frontière ne sont pas des barrières immobiles. Il y a une merveilleuse ambivalence dans le concept de limite. En latin, deux mots qui contiennent la même racine : limes et limen. Si le latin Limes signifie démarcation d’un territoire, ligne frontière (à l’époque romaine un poste militaire fortifié, et donc, en retour, une barrière entre l’extérieur et l’intérieur), limen renvoie plutôt à la notion de seuil, de lieu à traverser, donc d’ouverture vers l’espace extérieur, vers l’ailleurs, vers ce que l’on ne connaît pas et surtout vers l’autre de soi. En tant que limes, la frontière divise l’espace, sépare les lieux et les idées, les langues et les cultures, crée des différences et des fermetures mais, soulignant le concept de limen, elle présuppose aussi l’ouverture, le mouvement, le nouveau départ, le dialogue pluriel et inclusif : apprendre à reconnaître et apprécier les différences, les transformer en terreau fertile pour la recherche, l’expérimentation, l’évolution, la complicité et l’harmonie.
‘Ici’ et ‘quelque part aux confins du royaume’ sont deux poèmes qui dénoncent les frontières physiques, territoriales et personnelles de ceux qui se murent derrière la propriété, l’appartenance et l’exclusion de l’autre d’eux-mêmes. “Dans le silence de l’homme” raconte la vie pendant le confinement Durant les longues années suspendues du Covid. Enfin, “le Bosphore vu d’en haut”, imagine un espace sans frontières, dans lequel tout peut arriver.
L’image, Kittilä, Finlande, avec les cloisons horizontales tirées du verre, raconte un dedans et un dehors, des espaces mentaux.
trad. Marilyne Bertoncini
.
(1) – le poème « Quelque part aux confis du royaume » cité dans le texte est à lire sur la page Frontières (1)
.
Frontière délimitant France et Suisse, autour du massif de la Dôle.
Et délimitations de zones de pacage
.
Obstination et fierté de l’homme à refaire une frontière considérée maintenant comme « monument historique ». rénovations avec ciment (proscrites maintenant) pour maintenir les arêtes des pierres en état. Sur certains parcours, la frontière, tels de vieux ossements, s’écroule, se tasse dans le paysage et divague doucement.
Il y a beaucoup de passages larges pour le bétail. C’est donc une frontière parcellisée. et très ouverte, symbolique , surtout quand on voit sa hauteur qui n’arrête rien ni personne…
Obstination de l’homme à conduire cette arrête de pierres jusqu’en forêt profonde, sur des dénivelés décoiffants…
Elle me fait beaucoup penser à une colonne vertébrale, colonne qui maintient une perspective humaine aux paysages.
Elle finit mangée par le vert de la mousse, le marron du lichen, avalée par la terre… comme l’homme un jour prochain…
Florence Daudé
.
.
.
Paradoxes
.
Analogue à une lenteur, un adagio dans les cordes graves, la musique de ta vie accélère celle du monde. Intrigante expérience ; l’aube d’une journée, à l’époque du jardin d’enfant sur le plateau de Crête, te paraissait illuminer un futur d’une durée interminable. Tu n’envisageais pas la venue du soir lorsque, dans le bleu du matin, tu passais le portail de fer-forgé, que le sentier de graviers s’incurvait jusqu’à la statue, couronnée d’étoiles, d’une Vierge de Lourdes sulpicienne, si haute sur son piédestal harnaché de roses pompon ; contournait enfin l’aile gauche du bâtiment où se trouvait ta classe.
.
Mémoire, terrible mémoire : cette ligne qu’il fallait suivre sans renverser le verre d’eau plein à ras bord, dans la « salle de gym ». Les chants prenants des filles de quinze ans, les « grandes de première », dans la chapelle au plafond étoilé. À tes yeux de gamin, toutes semblaient admirablement gracieuses et attirantes. L’une ou l’autre remplaçait momentanément la maîtresse. Nous avions alors, nous hauts comme trois pommes, des conversations du plus grand sérieux. Elles ne se moquaient jamais des opinions auquelles nous avaient menés notre brève expérience de la vie. Au fond de mes souvenirs, pâlit doucement le visage de l’une d’elles, mince, grande, brune. Elle s’asseyait sans façons au coin de l’un de nos pupitres. Nous échangions sur mille sujets avec ardeur. Le soleil tombant par les hautes fenêtres, indiscret avare de lui-même, cueillait du soleil sur nos têtes joyeuses. En ce temps-là nous avions l’esprit vif. Le monde alentour peinait à suivre.
.
Aujourd’hui c’est l’inverse. Au pays de l’âge cassant, des impressions ralenties, des gestes mal assurés, le monde extérieur a pris tellement de vitesse, que c’est toi qui t’essouffles à vouloir le suivre après trois quarts de siècle. Sommé de continuer à lire, écrire, guetter le sens des choses, agir en somme : alors que l’énergie dont ta jeunesse maladive t’avait chichement pourvu, s’est encore amenuisée depuis. Ce qui te pousse insensiblement vers une inertie qui faisait dire paradoxalement à Joe Bousquet que l’homme immobile est le plus rapide de tous.
Xavier Bordes – in Poèmes de l’irréversible
.
.
.
Dessein de la tisserande
.
Les yeux à demi clos, je m’émerveillai cependant de l’écume des étoiles, de leur clarté de silence. Je quittai le belvédère et la nuit non sans maudire le calvaire édifié sur un amas de pierres sacrées. En contrebas, s’effritaient des bosquets de géhenne jusqu’à la mer qui remontait le jour.
En empruntant la ruelle qui menait vers les vivants, je guettais (non sans éprouver une impatience d’une qualité singulière, proche de l’angoisse) l’apparition d’une arche ouverte au flanc d’un mur relégué dans la vacuité de l’herbe sèche. Cette embrasure offrait à la vue du passant attentif l’amorce d’une sente jonchée de feuilles mortes. Dans la perspective s’entrelaçaient d’autres portiques, végétaux, qui fomentaient des complots de passages secrets, s’ouvraient des porches d’ombre qui instruisaient le désir de passer outre. Tandis que je marchais sur l’épais tapis pourrissant qui gênait ma progression, je perçus une curieuse sensation de frôlement sur le visage, une caresse filandreuse. Un brin de soie se brisait sur mes joues. Ouvrage ténu et têtu d’insecte tisserand. Un fil de la Vierge, comme disent les anciens. Je venais de rompre un lien séparant deux mondes.
Le village se partageait entre un port abrité et quelques demeures semées dans les terres.
Au pied de la falaise, s’étalait, non sans nonchalance, une langue de granit flanquée de cales. Au large s’ameutaient les barques des pêcheurs côtiers, glissaient de fines coques aux ailes blanches. Ici, chaque mortel prétendait vouloir partir. Tous voulaient donner l’impression d’être juste de passage. A peine une poignée d’évadés à chaque tentative. Ceux qui restaient affirmaient que cela se ferait la prochaine fois.
Les maisons du hameau se tassaient, enfouies dans un creux naturel protégé par des bossoirs de roc et d’argile mêlés, si proches de la mer et pourtant hors d’atteinte du vent. Je savais là un jardin où oscillait une balancelle. Un cheveu d’or pris dans une corde trahissait une fuite récente. Je me souvenais d’un pin qui sentait bon la résine perlée. Je revoyais la branche maîtresse d’un chêne sur laquelle lisaient deux enfants, pirates d’eau douce d’entre ciel et terre, qui détenaient une cargaison de livres d’aventures et un coffre plein de biscuits fourrés.
Descendre cet escalier dérobé avec sa rampe de métal rouillé qui blessait la paume et se retrouver les pieds pesant sur la pâte sablée de la grève, spongieuse comme l’oubli.
Gérard Le Goff In Cahier de songes, Editions Encres Vives, 2018
.
.
.
Risquer la frontière
quand le dehors ne se pense que par le dedans
dévider ce fil tendu entre joie et désir
détisser le voile au rythme d’une danse
dialogue alors est cette ligne mélodique du partage
les méridiens nomades partent en quête d’une structure matricielle qui se nommerait frontière
afin de mettre la vitesse en état limite
la toute allure fait éprouver sa peau par le dehors
et le dedans se prépare au choc frontal de la rencontre…
.
Fronti erre. Ne sait pas où il va. Ne sait pas même où il voudrait aller. N’est pas perdu mais s’est perdu. Ne sait pas qui il est. Sa mémoire déconnectée de ses yeux—qui balayent, explorent, fouillent les paysages, est une tumeur muette. Ni bénigne ni maligne : il n’en a pas conscience. Mémoire ou grenade non dégoupillée, pas encore. Une arme de reconstruction individuelle dont le mode d’emploi lui est inconnu. Il marche. Funambule diurne. L’élan de vivre impulsé jusqu’au-delà de son corps rendu dense par cette volonté aveugle. Intense.
Fronti ne comprend pas la question pourquoi. Comment à vrai dire le rend nerveux. Mais si vous prononcez quand, il rit, comme un enfant heureux. Il répond avec beaucoup de bienveillance, consciencieusement, mais ses yeux rarement se posent sur vous. Il ne soutient jamais aucun regard. Ne s’arrête jamais plus de cinq secondes aux côtés des humains. Il prononce des mots : ce ne sont pas des paroles pour nos oreilles arraisonnées.
Fronti a l’œil clair et hardi quand il marche. Il est comme une eau qui contourne et enceint. Limpide il va couler toujours plus loin son pas : Fronti erre et nous fait îles : nous les assaillis par les marées du doute et de l’interprétation. Nous qui voués aux surplombs et aux corniches hésitons à sauter. (Et pourtant comme nous nous employons à l’atteindre cette zone de débordement, terre promise de réparation, interface multi-volume du vivre vrai…) Fronti est toute aisance : son plongeon n’éclabousse jamais.
Fronti n’est pas adepte des sommets. Il en faudrait redescendre en marche arrière, en marche amont. Fronti n’a pas la folie des grandeurs. N’a pas l’ardeur de grimper. Son instinct peut-être le prévient qu’il lui faut préférer les cols, les passages d’altitude modérée. À la lisière des forêts. En bordure de torrents. La lenteur n’est pas son rythme. Il vit l’instantané de la tangente : cela convient parfaitement à son errance. Son langage en témoigne d’ailleurs. D’ailleurs il est—tout près, toujours sur un seuil.
Béatrice Machet
.
.
LES MOTS PORTES
.
Il en va de certains mots comme des portes. Les emprunter nous permet d’avancer, de franchir des obstacles, de découvrir des horizons nouveaux.
Ces mots-portes sont nombreux, mais certains possèdent plus de force que d’autres. Ils permettent de grandir, de réduire les distances, de libérer les frontières.
L’un de ceux qui a le plus de force pour moi est le verbe OSER. Oser prendre le risque de la rencontre, oser s’ouvrir à l’autre, oser dire que l’on aime, oser être faible parfois. Bien sûr, c’est courir le risque d’être blessé, mais, à toujours se refermer sur soi, ne risque-t-on pas de se nécroser ?
Juste derrière, vient le mot TOLÉRANCE. Accepter que l’Autre soit différent de soi, qu’il s’agisse de couleur de peau, de croyances ou de mode de vie.
Petite, j’étais fascinée par les escargots : leur capacité à se recroqueviller au moindre contact dans leur coquille était pour moi synonyme de sécurité absolue. Jusqu’au jour où j’ai compris qu’ils pouvaient aussi y mourir de sécheresse ou de froid, mais bien à l’abri…
Alors je m’efforce de ressembler à ces crabes qui, au risque d’être vulnérables, doivent se débarrasser de leur carapace, seul moyen pour grandir, ne pas végéter.
Avec crainte mais confiante, je tente de repousser mes frontières et j’ose m’ouvrir à ce qui m’entoure.
Chantal Plaine
.
.
.
RIVAGE
.
(La scène est baignée d’une lumière bleue, un tissu bleu y mime le mouvement des vagues, les acteurs viennent au-devant de la scène, depuis le fond, avant de parler)
LE BERGER : On est ici au bord du grand théâtre de la mer. Et la scène est mouvante. Émouvante et mouvante. Profonde et dangereuse comme peut l’être la frontière d’un rivage. Regardez ! Des personnages vont venir se briser, ainsi que des vagues muettes, ayant traversé des milliers de kilomètres pour déferler. Déferler ? je veux dire balbutier d’abord, chuchoter à peine du bout de leurs crêtes si le vent est contraire, et puis, à la fin, quand l’écume se gonfle, gronder. Et vomir des corps d’hommes, de femmes, d’enfants, parfois. Des naufragés. Je ne ressemble pas à une vague qui déferle et pourtant, ce théâtre où je suis est celui des brisants. Regardez. Respirez mes embruns. La plaine infinie de la scène derrière est celle de la mer. Les vagues y sont les langues messagères d’un au-delà marin, d’un au-delà terrestre plus loin que l’horizon. Observez ! Je ne suis qu’un porte-parole et, déjà, tout remue. Vous êtes devant moi, sur vos gradins-falaises, au sec, bien emmitouflés dans vos quant à soi et me voici à déferler mes phrases, sans que vous sachiez ce que cet océan que je convoque et je figure aurait à dire. A vous dire. Les grandes houles roulent aussi le silence des morts. Le claquement des dents de ceux qui ont survécu. Rien de précis, sûrement, un tumulte entouré d’une haleine, ce parfum violent et animal que vous humez parfois à marée basse et qui donne envie d’inspirer plus profond. Même la mort, ici, c’est de la vie, la nourriture de la vie. Vous êtes, vous, dans vos hauteurs, moi dans ce bain terrible qui mue et qui remue, et n’est jamais le même et grouille. Mais d’autres vagues vont surgir, des vagues et contre-vagues car l’océan que je prélude n’est pas celui, si serein et si beau de fin août, mais celui des tempêtes, des vagues scélérates, des tsunamis. Je viens de ces excès que rien ne borne. J’annonce un océan qui envahit. Et qui viendra frapper à vos falaises jusqu’à ce qu’elles s’ouvrent.
UN POISSON : La mer n’a rien de tragique pourtant, j’y respire. Et ces vagues hautaines qui vous effraient sont mes fées merveilleuses et soudaines, celles par qui je joue avec la transparence. Jeux de surface. Mes profondeurs sont autres et lentes. Ceux des miens qu’on arrache à l’amnios de la mer j’en devine le destin tragique. Prisonniers, soudain, de leur pesanteur. Nous sommes de la vie portée dans de la vie, mimant les vagues et glissant comme elles. Nous avons accointance avec la liquidité. Nous parlons peu puisque tout parle pour nous, qu’il nous suffit de danser et d’aller. Aussi vais-je vous laisser, en dire davantage nuirait à ma réserve, l’épaisseur de mon élément qui m’est secours et protection.
UNE VAGUE : Le Berger l’a bien dit, nous allons sans savoir où ni de quelle force. Nous sommes poussés à aller, nous succédant sans fin depuis le commencement de la Terre sans jamais nous appartenir, comme tout ce qui vit. Des ondes. Nous allons, nous brisons, érodons, par nous la vie est plus puissante que les murs.
UN TRÉPASSÉ : Bonjour Vivants ! Vous me voyez, me regardez et pourtant je me trouve de l’autre côté du regard, derrière la frontière d’où l’on ne revient plus. Vous avez du mal à m’entendre pas vrai, en principe ceux qui ont trépassé vont, silencieux, dans des chemins qui s’ouvrent et se ferment avec eux. Si je vous parle c’est que je suis un simulacre, une image pour ce qui ne peut se voir. Un masque. Je dis trop et trop peu. Revenu au néant au moment même où j’aspirais le plus à vivre, je me suis mesuré aux possibles et à l’impossible. Ceux des choses et des hommes. Et me voici inerte. Jouet des vagues, de la pesanteur. Quelle dérision ! L’océan m’a conduit jusqu’à vous mais aurait pu me ramener au large ou m’engloutir dans son silence. J’aurais mieux aimé sombrer plutôt qu’insister ainsi, aller, venir au gré des flots, sur ces lisières en écumes jusqu’à m’échouer près de vous, misérable. Me voici, marionnette consolante, puisque je vous parle d’un silence plus grand que vos idées, vos projets, vos désirs. Objet de votre compassion et de votre terreur avant de tomber dans l’abysse si profond de votre oubli. Ma parole, pourtant, vient de mon impensable. J’ai désiré vivre plus que tout, j’ai affronté le froid, la soif, l’angoisse, le moment où tout tient encore puis tout lâche. Le moment où la bête qu’on est, vacille. Tellement, que je ne suis plus rien. L’eau m’agite encore un peu mais aucun mouvement ne provient plus de moi. Les morts ne disent rien, les vivants, eux, ne cessent pas de parler de la mort. Je fais comme eux et suis un mort qui fait semblant d’être vivant, marionnette de vivant. Mais entre vous et moi, ce mur et ce vertige. Vous le savez mais … Je le vis. Et retourne pour toujours à ce qui est malgré moi mon silence.
UNE ABEILLE : Je butine, je passe. Une fleur qui vole. Un vent de terre, parfois, me pousse jusqu’à cet univers violent de sel, moi qui ne vis que du sucre des fleurs et de rosée. D’effleurer cet autre monde si puissant m’enivre. Et j’aime aller parfois jusqu’aux confins du continent et un peu au-delà, pour respirer ce monde irrespirable. Je suis fragile, je le sais, ne vis que peu de jours, et pourtant ma sagesse me dit que l’océan qui vit depuis plus de quatre milliards d’années est aussi fragile que moi. Nous sommes tous ensemble, les Vivants, réunis par nos fragilités. À contretemps et à contre-courant je vais à la frontière où je risque ma vie. C’est ma joie de vivant modeste. Et je la vis tant que vivrai.
Alain Nouvel
.
.
.
PLAT DE RESISTANCE
.
C’est novembre ou décembre dans les collines et dans la nuit tropicale ; les soldats thaï patrouillent – incessants mouvements de guérilleros basés au Laos, de l’autre côté du fleuve. Peur sensible dans leurs pas, vont par quatre ou six. Je me suis introduit clandestinement dans le camp de réfugiés, moi aussi je dois éviter les patrouilles – ma peur est celle des jeux de cache-cache de l’enfance. Pas d’électricité.
Terrine de lièvre à l’orange dans un salon de réception parisien, 2 cuillères à soupe de gin (recette pour 4 personnes), 20 g de pistaches, 80 g de lièvre sans la peau et désossé
Nouvel an Hmong (ethnie originaire de Chine ; persécutés par le pouvoir communiste lao car utilisés par les Américains durant la guerre du Viêt Nam) dans les cabanes accrochées aux pentes poussiéreuses où des cochons noirs cherchent leur vie parmi les détritus.
80 g de porc sans la peau et désossé, 140 g de lard fumé, 6 baies de genièvre
Quelques bières contre la peur et la chaleur. La patrouille passe. Porte de la nuit close hermétiquement.
La tricherie de la narration veut que je raconte cela à la première personne, comme si j’étais seul, alors que nous étions cinq : Arnaud, Gilles, Rolland et ce grand Belge grivois dont le nom ne me revient plus et moi. Tapis dans l’ombre.
La patrouille passe. Nous avançons au hasard. Nous voilà en bordure d’un quartier un peu à l’écart du reste du camp. On nous hèle. Invitation à manger un morceau et boire un verre d’alcool.
120 g de filet de lièvre pour la garniture, 1 cuillère à café de beurre, poivre noir du moulin
Dans la baraque où nous entrons quatre ou cinq personnes sont rassemblées autour d’un carton retourné qui sert de table. On s’assoit sur de petits bancs à 20 cm au-dessus du sol. Notre guide éclaire de sa lampe-torche la table et les commensaux. En voici un sans nez. La lèpre ! Le bouillon dans lequel surnagent quelques pattes de poulets délivre sa vapeur aromatique. Une cuillère de riz arrosée du brouet – citronnelle vraisemblablement, pour parfumer – et un verre d’alcool de contrebande avalé cul-sec.
½ cuillère à café de zeste d’une orange non traitée, ½ cuillère à café de zeste d’un citron non traité, sel, 2 tranches de lard fumé pour tapisser la terrine, 2 tranches de langue de bœuf ou de veau, salée et cuite (environ 50 g)
Les pattes de poulets (environ 50 g) flottent ; à part le riz, c’est le seul mets un peu consistant de ce repas de fête. Inexorablement mon regard est attiré par ce visage sans nez (sans la peau et désossé). Les cochons noirs grognent dans la nuit. 200 g de confiture d’orange amère pour la sauce. Alcool de riz qui traverse le Mékong sur des barques légères, discrètes, des barques pleines d’hommes, d’armes, d’alcool, 2 cuillères à café de Grand-Marnier, 2 cuillères à café de Campari Bitter, ainsi voilà le quartier des lépreux, tenus loin de tous, on en a peur, saveur du bouillon parfumé, brûlure de l’alcool, 2 cuillères à soupe de jus d’orange, 2 cuillères à soupe de jus de citron, 1 cuillère à café de jus de raifort, poivre de Cayenne, sel, lèpre, passer à la maison voisine, mêmes corps marqués, même pauvreté chaude et simple et joyeuse de recevoir, riz, lèpre, bouillon clairet, riz, pattes de poulets, alcool, alcool, alcool, lèpre, ivresse, tout s’accélère, j’apprends la formule pour dire « bonne année » en langue hmong, la prononce approximativement pour les sourires des hôtes rassemblés dans l’accueil, boisson recommandée : un Bourgogne, un Bordeaux ou un Pinot noir
Saveur désossée, plaisir d’être là, chaudement serrés autour, préchauffer le four à 140°C, autour de la table-carton renversé, visages sans la peau, sourires, petits verres de lao- lao qu’il faut vider très vite, bonne année, on passe à la maison voisine, à la maison voisine encore, à la maison voisine, encore, encore, plus manger, merci, bonne année, boire, visages, remplir la terrine d’un tiers de la préparation réduite en fine purée, le fleuve d’alcool nourrit l’incendie des épices
Marchant dans les collines précautionneusement – les patrouilles, les serpents, retrouver le chemin vers la brèche dans les barbelés – je suis la particule qui vole dans la fumée, le rêve d’un opiomane sans la peau…
Jean-Christophe Belleveaux
.
.
.
Un monde en couleurs
Petite, j’aimais dessiner des cartes. Chaque semaine, la maîtresse nous demandait d’en décalquer et de les colorier. Il s’agissait toujours de régions de France, jamais nous ne franchissions les frontières.
Aussitôt les contours fidèlement reproduits, je m’attaquais au coloriage. J’ouvrais la boîte en métal dans laquelle s’alignaient mes douze crayons et je commençais toujours par les tailler méticuleusement. La mine des crayons de mauvaise qualité se casse tout le temps. Les miens, non. Je choisissais avec soin les coloris, l’ensemble devant être harmonieux. Le vert n’aime pas côtoyer le bleu, mais il s’entend à merveille avec le rouge. Mes crayons étaient un peu gras et la mine glissait doucement sur le papier, sans l’agresser. Une fois l’ensemble colorié, je déchirais un petit morceau de buvard et je frottais doucement la surface colorée. L’ensemble se devait d’être bien régulier, les traits de crayon invisibles.
Tout en coloriant, je voyageais. Je passais du Puy de Dôme bleu au Cantal orange. Je suivais le contour violet de la Bretagne en faisant bien attention de ne pas tomber dans la mer turquoise. Je n’ai jamais mémorisé la position géographique des différentes villes, mais je savais que Lille était dans une région rose. La France était multicolore et c’était bien joli. Pour moi, ailleurs, tout était gris.
Beaucoup plus tard, mes parents m’ont emmenée en Belgique après une soirée passée à Lille. Nul passage du rose au gris, pas même un poste-frontière. Je ne sais même pas si j’en ai été déçue…
Chantal Plaine
.
Faux pas
Vous savez, d’où je viens, on me répétait tout le temps « Ne franchis pas la ligne, gamin, tu sais que c’est la limite ». C’était quelque chose de dingue, je trouvais cette phrase dans toutes les bouches !
J’ai fini par croire qu’il fallait vraiment faire gaffe : et là, si je pose mon pied, y’a pas cette maudite ligne quelque part ? Un vrai parano ! Je n’avais pas dix ans que je tremblais déjà à l’idée de mettre un pied devant l’autre.
Le pire dans tout ça, c’est que pendant que je m’acharnais à chercher cette ligne, appliqué comme je l’étais à ne pas la franchir, j’en oubliais cette histoire de limite… Bim, je finissais toujours par m’en prendre une !
« Je t’avais dit de ne pas franchir la ligne, gamin, je t’avais prévenu ! »
Je n’ai jamais bien compris comment j’arrivais à franchir cette ligne sans jamais la voir.
Et puis ils sont arrivés de nulle part. Un gars apeuré est revenu au village en hurlant « ils arrivent, ils arrivent, ils ont franchi la ligne ! »
Pourquoi s’excitaient-ils comme ça ? Après tout, ils m’avaient, moi, le spécialiste en la matière !
Il a fallu que je les voie pour comprendre que nous ne jouions pas dans la même catégorie.
Ils avaient de jolies jeeps et de vrais fusils. Des machettes aussi. Et des bouteilles à ne pas boire, remplies de chiffons.
Les derniers mots que j’ai entendus furent « oh non ! Ils sont là… » Ils ont ouvert le feu et l’ont allumé. Parfois, ils ont tranché dans le vif, d’autres fois ils ont fait des prisonniers.
C’est pratique, les prisonniers, on fait ce qu’on veut avec. Parfois, même, on les vend.
Et puis, aujourd’hui, me voilà : je suis toujours là ! Je n’aime pas parler de comment j’ai survécu ni de ce que j’ai dû faire pour en arriver là. Probablement que j’ai encore franchi un paquet de lignes sans m’en apercevoir, parce que j’ai morflé.
Et puis, finalement, j’ai appris à les franchir discrètement. Je ne les voyais toujours pas, mais je ne me faisais plus prendre. Comme si j’avais développé un sixième sens me permettant de détecter ces foutues lignes invisibles.
D’ailleurs, ici et maintenant, je le sais, il y a une ligne, juste là, à mes pieds… Quelle blague : Il n’y a plus personne pour me prévenir de ne pas franchir la ligne et, pourtant, je n’ai jamais été aussi effrayé de le faire !
De l’autre côté, je ne serai plus une cible, un paquet ou une bête. De l’autre côté, c’est la liberté et la vie, on me l’a dit. Comme un paradis pour les franchisseurs de lignes, en quelque sorte. Un endroit où les jeeps, les fusils et les machettes sont bannis. Une oasis éternelle où l’on ne remplit pas ses bouteilles de chiffons inflammables.
J’ai encore du mal à y croire. Je m’en suis tiré… Vraiment ? De l’autre côté, je serai tiré d’affaire ? Ça semble si simple et si absurde que je tremble à l’idée d’avancer. Et si je le faisais ? Si je tournais la page, que deviendrait ce gamin distrait qui passait son temps à chercher des lignes imaginaires ? Et si je n’avais plus de lignes à franchir ? J’ai si peur. Je ne suis qu’à un pas d’abandonner mon histoire et de commencer une nouvelle vie.
Il le faut : Qu’elle soit nouvelle, bonne et belle. Je ne veux plus mourir de ligne en ligne ; je veux vivre, une fois pour toute. Alors, je ferme les yeux, j’imagine une ligne, une dernière fois, et je mets un pied devant l’autre, avec un léger déséquilibre, comme pour la première fois.
Quand je suis arrivé à cette ligne étrange
Qui ne se voit que du point de mire des anges,
Le pas de plus que je fis métamorphosa
Mon être, si bien que je me fis mimosa.
Laissant derrière ma condition d’humain blême,
Je fleuris, pris racine et me fis tout poème.
C’est alors que j’ai rencontré cette mutine
D’abeille
Qui, chaque journée, me butine et me conseille.
J’en oublie souvent l’humain que j’étais avant
D’unir ma force à celle de l’eau et du vent,
Temps fou où je marchais sans savoir où aller.
Derrière la ligne, le soleil qui se lève
Me rappelle la vie qui pulse dans ma sève,
Avant la cueille et la perte de ma vallée.
P.Y.Xyn
.
.
Le Troupeau clandestin – Avant-propos
.
Cette nouvelle a été écrite à partir d’un fait divers qui, aussi anecdotique fût-il à la base, parut révéler la terrible complexité et l’ambivalence de toute trajectoire humaine. Elle évoque l’absurdité de certains élans humains et volontés politiques, la naïveté le disputant au désir de domination. Dans l’intimité comme dans la vie sociale, il y a toujours un « Est » et un « Ouest ». Qu’en est-il quand on passe de l’Est à l’Ouest ? Est-on sûr de gagner en liberté fondamentale ? Ce qui ne veut pas dire non plus que l’on doive rester là où l’on est.
.
LE TROUPEAU CLANDESTIN
« et mes habits ont la semblance
de tes champs rayés jusqu’à l’horizon…
et digérés jusqu’à mes aïeux par la plaine
je disparaîtrai ridicule comme un lord
sous le jupe des bohémiennes »
– Mircea Dinescu –
.
Toute la journée, le soleil. Avec des accents métalliques. Il avait tourné très vite. Une roue ferroviaire. C’est tout à fait cela. Et qui faisait se rejoindre le ciel et…. On pourrait dire aussi le visible. Le visible et l’infini. À donner le vertige et même un peu d’angoisse si l’on se penchait en arrière pour le regarder. D’heure en heure. Sa rotation. S’accentuait. Si, vraiment. Votre impression est bonne. Comme un mécanisme détraqué à la base. Quelque chose de complètement fou. Une liberté de mouvement que plus aucune force ne contrôlait. Vous n’y croyez pas ? Les bergers pourtant y croyaient. Ils avaient même prévu le phénomène. Quels bergers ? Ceux qui descendaient des montagnes. Vous en avez déjà entendu parler. Ou alors vous n’y avez pas prêté attention. Est-ce qu’on a pour habitude d’écouter des bergers ? Quand ils voient les choses de fort loin, pourquoi pas ? Ainsi, depuis plusieurs jours, ils avaient remarqué. Invention ! Arrête ! De l’affabulation. Ils disaient que la forme même de la plaine changeait. Arrête, on te dit ! La plaine s’allongeait. Une amande tôlée, frappée de plein fouet par les rayons. Cela faisait un bruit ininterrompu de tonnerre. Du blé, des fruits à perte de vue. Voilà ce qu’ils regardaient les bergers. Ils avançaient lentement. Au rythme effarouché de leur troupeau. Ils avaient un peu peur. Qu’elle ne leur mente, la plaine, vue d’en haut. Tu ne voudrais tout de même pas qu’on les rassure, tes bergers ! Laisse-les donc. Tais-toi. Parcourue de sillons bruns qui se croisaient, s’enlaçaient comme des ramures. Belle plaine, vraiment ! Les bergers racontaient que les sillons se dressaient et venaient dans leur direction. Ils restaient fascinés par leurs convulsions de serpents. Une rivière traversait la plaine. Son cours était étrangement calme. Tenez, comme vous. À ignorer le trouble qui par instant saisissait ses berges. C’était une rivière sage et bleue de carte géographique. D’où tirait-elle cette tranquillité ? Vous vous posez la question, tout comme les bergers. On ne te demande rien. L’hypothèse retenue par le berger principal. Ne dis rien. L’hypothèse la plus fréquente était qu’elle avait pris sa source dans de paisibles régions montagneuses. À moins qu’elle n’anticipe le voyage qui lui ferait un jour rejoindre le Fleuve. Ce n’est pas émouvant, ça ? Les bergers s’arrêtaient souvent. C’étaient de grands contemplatifs. Et respectueux avec ça. Ils attendaient toujours le signal de leurs trois chefs. Il y avait. Laissez-moi me souvenir. Alexandru, Lucas et Andrei. De bons pasteurs, ces trois-là ! Élus de la façon la plus démocratique qui soit. Ce qui les rendait fiers de leur élection, tenue secrète bien sûr. Alors, pourquoi le révéler ? Attendez donc qu’ils aient traversé la plaine. Sachez seulement qu’ils se sentaient, eux huit, oui, oui, aussi nombreux que ça. Qu’ils se sentaient les premiers en quelque chose de très important. Même s’ils en ignoraient encore toute la portée. C’est trop long, parle ! Vous ne comprendriez rien pour l’instant. Alors tais-toi. Le troupeau était lent. Sans les chefs qui les incitaient à la patience, ils auraient fini par abandonner le projet. Ou par perdre espoir. Parfois ils soupiraient. Que ne rompaient-ils pas la chaîne qui les reliait aux bêtes. Ils s’imaginaient dévaler la pente, courir dans l’immensité de la plaine. Le troupeau les entourait de sa marche cadencée. Ils se résignaient, c’est cela ? Les animaux, doucement, se resserraient autour d’eux. Ils ont l’air sots, tes moutons ! C’est vous qui le dites. Les moutons prévenaient toute fuite. Deux mille bêtes, c’est une frontière sûre entre la fidélité et la précipitation. Sans compter les agneaux nés depuis peu. Puis l’âne. Il y a même un âne ? Au milieu du troupeau, et lourdement chargé de vivres et de couvertures. Comme s’ils les avaient élus, eux aussi. Cela donnait à réfléchir. Tout de même, ils auraient bien voulu arriver à la plaine de jour ! Le soir était tombé brusquement. Cette absence de transition bouleversa les bêtes. Des bêlements prolongés. Beaucoup d’oiseaux volant bas. La nuit, il se mettait à pleuvoir. Depuis leur départ, il pleuvait chaque nuit. Tu l’as déjà dit. C’est important. Parce que la pluie, elle était filandreuse. Et elle nouait leurs pas. La houlette fourrageait parmi les toisons. Les bergers n’avaient plus l’impression d’être des bergers. Ils halaient la barque lourde du troupeau. Avaient-ils peur ? Les cris des animaux donnaient les limites du silence et de la nuit. Redoutaient-ils l’immensité de la plaine ? Ils s’inventaient des frontières, à intervalles réguliers. C’est idiot, ça ! Qu’ils s’ingéniaient à passer sans se faire repérer. Pour l’un, c’était un rideau d’arbres si dense qu’il aurait fallu se tailler un passage à la hache. Pour l’autre, et c’était vraiment banal à côté de la haie de peupliers, un mur. Ainsi de suite. Jusqu’au dernier qui annonça un champ sans aucune clôture mais planté de fleurs si rares que nul n’oserait les fouler. Alexandru, Lucas et Andrei ne cherchaient pas à mettre fin à ces histoires. Ni à tranquilliser les esprits. Alors, à quoi servaient-ils ? Ils n’étaient pas sans peur non plus. C’était pour eux une épreuve nécessaire. Ils auraient plutôt dit : incontournable. Une sorte de frontière ! Il leur fallait. Vaincre. L’angoisse, le souvenir et l’habitude. « Accrocher des poires au peuplier »[1]. D’autres avant eux l’avaient fait : les étudiants de la capitale. Jusqu’à ce que des choses inhabituelles sortent de terre. « Des roseaux fleuris de giroflées »1. Ils avaient attendu les premières lueurs dans une vieille bergerie dont une partie du toit seulement était intacte. Néanmoins, ils avaient réussi à allumer un feu. L’âne, avec ses grandes oreilles, paraissait porter deux flammes sur la tête. À l’endroit du bât, le poil luisait. Les agneaux s’étaient blottis contre lui. Il brayait. Une incantation, avait dit Andrei dans un soupir. Vous entendez, vous aussi. Et les rougeoiements du feu par les trous de la façade ? De l’extérieur, ça fait comme un tabernacle. Non ? Une vision démoniaque. Cela vous semble plus juste ? Mais je ne sais pas qui a eu cette idée. Les bergers avaient sorti un jeu de cartes. À cause des gestes rapides des joueurs, les figures de carton, une à une, parurent s’élancer dans le feu. Où elles se tordaient, grandissaient démesurément avant de disparaître. Ils s’étaient mis à raconter des histoires. Le plus souvent celles de la famille : un héritage, une brouille, un mariage. Parfois, ils pleuraient. Comment savoir si l’on avait assez aimé ? Est-ce qu’on pouvait trop aimer ? L’âne ! Et bien, quoi, l’âne ? Il vous a empêchés d’entendre ? Il y en a un qui racontait des passages entiers de la Bible en prenant pour personnages ceux de son village natal. Pas forcément de sa famille. Bien qu’ils soient tous plus ou moins cousins dans un aussi petit village. D’autres se taisaient. Les mains modelaient sans relâche une boule de terre. Ce qu’ils voulaient en faire ? On n’en sait rien. C’était humide et chaud. Ce n’est pas une raison suffisante ? Peut-être que si. Le café qu’ils buvaient était amer. Comme il y en avait trop peu pour eux tous, ils avaient rajouté des herbes pilées qu’ils utilisaient habituellement pour les tisanes. Lucas s’amusait à compter à voix haute les étoiles qui jouaient à cache-cache avec la nuit pluvieuse. La lune ! Un vrai corbeau avec son bec jaune. Ça ne fait rien, le jour allait bientôt poindre. La plaine avait toujours son air de grand animal sensible. Une antilope arrêtée dans sa course et prise dans un cauchemar. C’est ce que tu dis mais ce n’est pas forcément vrai. L’apparence illimitée du paysage confinait à l’immobilité. Tais-toi, c’est faux. Les bergers le disaient. Si ce sont les bergers, alors… Les épis de blé étaient encore très courts. Avec la couleur du désert. Le vent bandait les champs comme des arcs. Les alouettes avaient du mal à prendre leur envol. Les bêtes, à présent, devançaient les bergers. Elles les entraînaient. Alors qu’ils auraient souhaité retarder l’arrivée devant la frontière. La vraie, cette fois-ci. Du moins celle que d’autres hommes qu’eux avaient inventée. Ils hochaient la tête devant la plaine. Un peu incrédules. C’est ça la plaine ? Les solides montagnards qu’ils étaient marchaient avec difficulté dans la terre poudreuse. Presque sableuse. Bon, pour traverser la plaine, il suffisait d’aller tout droit. C’est ce qu’on leur avait dit. Une femme, à ce qu’il paraît. Ajoutant que les villes, les routes, les cultures viendraient à eux de fort loin. Le plus étonnant était qu’elle n’était jamais sortie de son village. Il y a des choses parfois. Le bassin était sacrément fertile. De temps en temps un berger se baissait pour toucher la terre. Ou vous cueillir un épi. Juste un qu’il glissait sous sa chemise. Même que ça le chatouillait un peu. Vous riez ? C’était riche par ici, alors pourquoi s’inquiéter du lendemain ou d’une direction à prendre. De toute façon, ils obéissaient scrupuleusement au mot d’ordre : ne pas se retourner. Malgré la peur qui revenait de temps à autre. Ne pas tourner la tête vers les sommets assombris de bois. Veiller à la rectitude du chemin qu’ils avaient pris. Ils jugeaient ne pas se trouver bien loin de la métropole. Lucas rappela donc que les étudiants avaient voulu faire sauter l’usine pétrochimique. Il relatait les faits en choisissant ses mots avec soin. Voulait-il impressionner son auditoire ? Vous pensez que c’est mal. Se prononcer est difficile. En tout cas, il était heureux de jouer à l’envoyé spécial. S’il l’avait été effectivement, il aurait pu croire, ayant couvert l’événement, avoir lui même participé à l’action des étudiants. Déjà, au village, il avait acquis une solide réputation de conteur. Maintenant tous les bergers regardaient dans la direction qu’ils imaginaient être celle de la ville. Et ils regardaient avec beaucoup de respect pour l’université. Les vanneaux montaient très haut. Leur vol dessinait un triangle dont la pointe n’en finissait pas de s’effilocher. Puis soudain ils revenaient vers eux, leur huppe noire presque menaçante. Vous voudriez empêcher les bergers de prendre les augures ? Ils ne parlaient plus beaucoup. De temps en temps un sourire amical, cela suffisait. Ils marchaient en aveugles. Guidés par le roulis blanc des moutons. La plaine brillait. L’intensité de la lumière les gênait. Tu l’as déjà dit : ils étaient comme aveugles. C’est autre chose à présent. Ils ne regardaient plus. Ils se sentaient en prison. Chaque pas tissait un lien plus ténu avec le quadrillage des cultures qu’ils continuaient à admirer par ailleurs. Le spectacle les avait étourdis. Comment détourner le regard de cette propagande de maïs et de tournesol ? Alexandru leur avait dit qu’ils avaient le droit de faire appel à leurs souvenirs. Ils étaient assez loin des montagnes maintenant. Lui-même avait commencé avec la rivière de son enfance. Rappelant les heures passées à contempler les reflets des ormes dans l’eau. À hauteur du barrage… Ils se rappelaient avoir déjà entendu Alexandru le raconter. Ces reflets-là, recouverts par l’écume puisque c’était le barrage, avaient pourtant une taille et une vigueur sans commune mesure avec les ormeaux de la rive. Le berger a poussé un « ah » ému. Ces reflets, c’est comme s’il se déplaçait sur eux. Tu exagères ! Comme sur un nuage. Qui avance, toujours sur le point de se désagréger. Parle-nous plutôt des cultures. Malgré la fertilité, c’est la désolation qui domine : les épis encore ras et si rêches au toucher, le claquement sec des cailloux, la course infernale du soleil. Le barrage, le barrage ! Vous voulez qu’on en parle du barrage ? On y arrive pas à pas. Ou on y revient. En fait, quand il avait été construit, les eaux avaient englouti le village de son enfance. Ce qu’il venait chercher là après, c’était une image, une ruine. Des trombes d’eau. Il le répétait. Un rideau épais. Un rideau de théâtre descendant sur le village. Un rideau noir, a dit brusquement Andrei qui marchait en tête. Derrière eux la plaine brillait toujours autant. Mais elle avait pris l’éclat un peu dur de la lumière artificielle. Devant eux la nuit qui était tombée si brutalement. Que s’est-il passé alors ? Un agneau s’enfonça et disparut. C’est agaçant à la fin : des moutons, des agneaux, des moutons. Une partie du troupeau suivit. Les bergers, emportés par le mouvement, emboîtèrent le pas aux bêtes. Ils sont stupides ! Le silence et la nuit, frais, épars. Ils se glissaient dedans. Ça s’écarte ! Encore un berger qui raconte des histoires ! Un phare, un cri, un projecteur qui balaie l’obscurité. Nous aussi, on les a vus. Pourquoi ne sont-ils pas restés dans la jolie plaine ? Arrête-toi là ! Un bloc de bêtes et d’hommes qui avancent. La nuit qui s’est interrompue. Un rideau de pluie qui l’a remplacée. La terre mouillée avait une odeur de friandise. Des moutons s’étaient égarés. Il y avait eu cinq nouvelles naissances. L’âne boitait. Lucas parlait d’une vie nouvelle. Il suffisait de marcher, prétendait Andrei. Un vieux berger consultait une carte. Il grommelait qu’il voulait voir la mer. Laisse-le faire ! Quand il aura vu la mer, tu ne t’en occuperas plus. C’est comme une brebis malade, ce vieux. Avec sa carte, il avait guidé leur route plusieurs jours de suite. Hasard, intuition ou calcul, ils s’étaient retrouvés sur la côte. Là, dans ce théâtre en plein air surplombant l’Adriatique. Un peu sur la gauche, les palmiers et les dômes luisaient. Une pointe de terre plongeait dans la mer. L’émotion que ça leur faisait. C’était aussi violent qu’une épée. Est-ce que cette scène ne pouvait pas abîmer le cœur naïf des bergers ? Des touristes, nombreux, les côtoyaient. Qui les mettaient sur le compte du folklore. Sans doute qu’ils riaient de les voir ! Vous voudriez qu’ils les ridiculisent ? Moutons, bergers, agneaux – les agneaux, c’est doux et amusant ! – moutons, bergers. Tais-toi ! Laisse-nous tranquilles ! Sur les gradins, assis, des touristes, des bergers, Alexandru, deux ou trois touristes. Chut ! On voudrait bien se reposer sur les gradins, assis avec les touristes, les bergers, si tu veux. Parmi les moutons qui somme toute se fondaient très bien dans la foule. La plus vieille bête du troupeau descendit sur la scène la première et sans raison apparente se jeta à la mer. Arrête ça ! Alors ce fut la bousculade : un troupeau furieux suivit. Des moutons blancs, des hommes avec leurs chapeaux et leurs lunettes de soleil. Des brebis noires, des étudiants, des femmes bruyantes. Non ! Arrête-toi ! Une jeune et jolie femme et même deux ou trois bergers. Ne poussez pas ! Un homme, torse nu, plusieurs bêtes, à l’eau eux aussi. Tu ne nous as pas dit la vérité. C’est complètement fou ! On n’y voit plus avec la réverbération du soleil sur la mer. Un, deux, trois… Encore un ! Quelques notes de musique. Un transistor oublié sur un banc. Quand tout fut fini, les autres pasteurs sortirent, les uns de derrière les murets, les autres des gradins entre lesquels ils s’étaient accroupis, le visage caché dans les mains. Seul sur la scène, un agneau essayait de se relever, les pattes tremblantes. Lucas se précipita vers lui en hurlant le nom de Liberté tandis qu’Andrei criait : « À mort ! À mort ! » L’agneau, debout à présent, mais plutôt sans expression. Lucas, Andrei, deux ou trois autres autour de lui. Puis un homme qui fut précipité à la mer. Puis un silence. Encore l’agneau qui paraissait plus grand et plus gros. Voilà, voilà. Andrei répétait, sans crier cette fois-ci : « À mort ! »
— Tu as raison, et si on le mangeait ? demanda une voix ridiculement fluette mais que l’on entendit parce qu’il ne restait presque plus personne et que l’acoustique était extraordinaire dans cet amphithéâtre.
Chantal Danjou
[1] proverbes roumains marquant le défi.
.
Parenthèses
(extrait)
Pour toi, tout a commencé, c’est-à-dire ton premier enchantement direct avec le lac, en 1943, à Genève. Tu avais deux ans. C’était la guerre. Seconde naissance. Tu étais là sans le comprendre, en réfugié, mais paraît-il, tu en avais eu l’intuition, en ne bronchant pas, dans les bras de ta mère, lorsqu’il avait fallu se déchirer aux griffes d’acier, à quelques dizaines de mètres des soldats allemands, précédés de chiens zélés… Ne pas hurler. Ne rien dire. Se blottir. Attendre la paix de l’autre côté de ce providentiel espoir de barbelés…
Première parenthèse ouverte d’une rive à l’autre rive. D’une vie à l’autre vie. Tu t’y engouffres. T’y suive le lecteur s’il ne craint les éclaboussures en haute mémoire…
A deux ans donc, fuyant l’enfer, tu étais recueilli en cet envers de la terreur, dans l’appartement de Lucy, ta grand-mère maternelle, rue de Monthoux, au-dessus d’une boulangerie pâtisserie débordante de chauds parfums. Les immeubles mitoyens ont été par la suite démontés pierre à pierre pour être transplantés ailleurs. L’actuel grand casino s’est amarré à quai, grand navire de béton et de verre, rejetant chaque nuit quelques naufragés n’ayant pas su percer le secret des coffres d’une insondable île au trésor souterraine…
Là, deux années durant, tu as découvert la corne du Léman, à courtes enjambées. Tu as aimé aussitôt ce goulot d’étranglement du lac. Tu y as abouché ton enfance. Tu en as gorgé ta rétine. Avidement. Oh ! Etait-ce vraiment votre lac, en majesté dans son enclave montagneuse, dont tu irriguais ta joie d’être au monde ? Tu aimais la danse des voiles, le balancement nonchalant des barques de pêche, les grands bateaux à roues aux arrogantes stridulations, les petits canots à moteur hoquetant ou aboyant dans leur sillage.
Tu aimais le pain sec pour les cygnes, défi aux restrictions. L’envol tourbillonnant des mouettes vitupérant. Le petit train de bois polychrome remorqué de la main, sur le quai, à la merci des saboteurs potentiels de la promenade, indifférents à tes voyages oniriques. Le prestigieux jet d’eau, douchant le ciel et maintenant à distance les bombardiers fous de l’Europe en guerre…
Margelle de sécurité sous d’heureux auspices.
Tu portais à ton cou le collier léger de la Croix-Rouge (Matricule : GE 9419). Tu ignorais l’étoile jaune. Tu ne devais pas mourir à Auschwitz comme tes grands-parents Marcos et Rébecca restés à Lyon, dans la tourmente, et que jamais plus vous ne reverriez…
La Suisse, c’était l’asile, le Pérou des parias de la domination nazie, de ceux tout au moins qui avaient eu la bonne fortune, dans leur misère, de n’avoir pas été repoussés à coups de crosse ou de talon.
[…]
Parenthèses pour parenté. Parenthèses en aparté. Du petit port d’Amphion, fuyant l’occupation, des familles juives purent gagner de nuit la rive suisse, échappant aux trains de la mort. Toutes n’eurent pas cette chance… Du port de Rives, à Thonon, Mendès France lui-même s’embarqua, après son évasion de la prison de Clermont-Ferrand, pour rejoindre Londres, en été 1942, sauvé par les pêcheurs professionnels Louis Duchêne et Lolé Lugrin. La barque a vieilli mais elle est toujours ancrée à la même place. De la guerre mondiale à la guerre d’Indochine, elle a tout de même changé de nom. C’était « Oncle Paul » puis ce fut « Oncle Ho »… Allez savoir !
Michel Ménaché
Rue Désirée, une saison en enfance – Ed. La Passe du vent, 2004
.
.