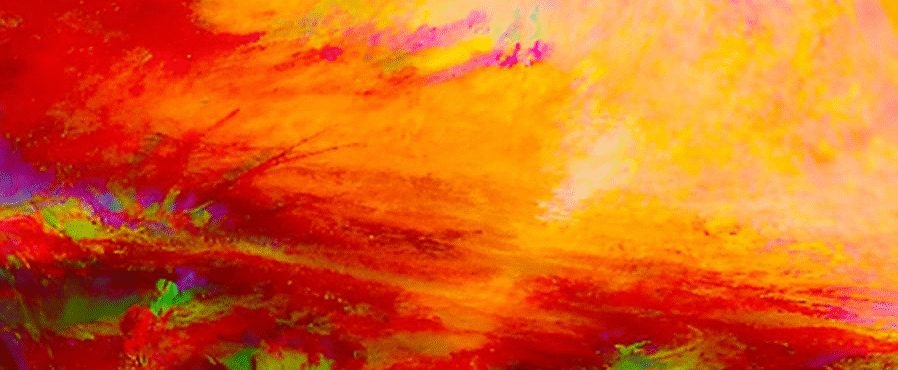composition numérique mbp
.
.
Déserts de terres salées que répugne le ciel
Vendeurs de joies maudites sur le grabat d’une terre enfouie sous les décombres de deux siècles d’angoisse
Passez, otages des ruses fécondes
Les yeux bandés, passez
Passez, joyeux fous au comble du délire
Passez, insouciants
Mes vers se saoulent du tafia des eaux fatiguées,
De la carcasse moelleuse de cette terre vendue aux luxes de l’oubli
Passez, je vous en prie, amants des révoltes inutiles qui jonglez avec les mots pour exciter vos rêves
Je n’écris pas pour vous ce long roulement de tambour qui déchire la nuit,
Cet éventrement des clowns au cirque des paradis perdus — c’est un poème ancien, ce sont des mots parjures que je chuchote aux oreilles de mes nuits quand j’ai faim de merveilles inconnues.
Vous n’y comprendrez rien, c’est le bâillement innocent d’un cœur muselé de joies improvisées,
Lorsque le cri des torrents ne pouvait plus s’entendre que dans la voix des plaines amaigries, qui vendent cher leur peau au marathon du dénuement.
Je n’écris pas pour vous, vos mains sont rouges encore du sang de mes soleils et de la détresse de nos mornes en péril.
Je n’écris pas pour vous, fournisseurs d’obus aux mercenaires de nos guerres.
Ah ! Césaire, depuis deux siècles, les chiens n’ont jappé chez nous que de ces aboiements sordides où ils s’en prennent à eux-mêmes.
Ils attendent que, sur l’eau, les sillons menaçants se dissipent dans le mutisme le plus total.
C’est ma terre qui va là, dans la déchirure au cœur de l’Occident,
C’est ma terre,
Cette épave perdue au fond de l’océan, victime de cette guerre que livre le néant du rêve au néant de la vie.
Déchiffre le beuglement du bouc à l’abattoir,
Le saignement vers la mer de ce qu’étaient ses rêves, alors vous comprendrez ces félons de mots, délateurs, hélas, qui s’acharnent contre le calme de vos nuits,
Ces tournures maladroites qui meurent sur le papier tandis que vivent dans le temps ces cris, hélas, trop forts pour votre entendement.
Pardon si je délire de fauves images qui font fi des lois du langage pur.
Ce sont mes mots de passe à la frontière des folies du mal d’aurore.
Je n’écris pas pour vous.
Les chemins que j’emprunte ne mènent plus vers Furcy ou à Fermathe.[1]
Je traverse, forcené, ces corridors violents pavés de tout le sang de mes nuits suicidées.
C’est Martissant qui harcèle mes jours d’angoisses.
C’est Bolosse[2] qui traîne son trépas dans ma mer morte.
C’est Site Watè, Cité Katon, Cité Soleil, Lakou Kochon, Lakou Mango[3] que j’invite aux festins de mes maux.
Sur le gibet, là-bas, des Coicou[4] meurent qui ne furent pas,
Ces Carl Brouard[5] un peu amers qui sarclent en leurs cœurs l’ivraie des vies faciles ;
Je n’écris pas pour vous qui peuplez vos salons de violons saugrenus,
Qui vendez à nos enfants les printemps du vide, ces saisons dans la cage morbide des jours défigurés.
Passez, je vous en prie.
Passez votre chemin, ne vous attardez guère aux plaintes de mes mains.
Mes doigts rechignent sur le papier et versent des pleurs d’encre qui vont s’abîmer contre les remparts du temps,
Tandis qu’en moi s’agitent tous les volcans,
Toutes les colères refoulées de nos enfants,
Tout le fracas à double cri de nos gueules insoumises dans les goulags du silence… de votre indifférence.
Passez, vous, aux vers de verre qui flirtent avec les fleurs.
Passez, vous, à la peur qui pleure dans « la chronique du temps qui passe ».
Vous, au rire « bon enfant »,
Vous, aux regards vendus dans le spectacle de nos douleurs.
Votre voix soudain attrape la grippe du coupable.
Comment comprendriez-vous le langage sans raccourci du baobab,
Ce chant gonflé du tafia de nos plaines, titubant vers la mer dans le courant macabre des rivières, dans leurs gestes de putains avilies au bar du soleil ?
Comment comprendriez-vous ?
Ce sont les hiéroglyphes d’une civilisation éteinte,
La voix du crépuscule dans sa langue conquise.
2012
notes :
[1] Agglomérations huppées dans les hauteurs de Pétion-Ville en bordure sud-est de Port-au-Prince.
[2] Le quartier où j’ai grandi du côté sud de Port-au-Prince.
[3] Autres “enfers” de la violence et du dénuement dans la périphérie de la capitale.
[4] Massillon Coicou, poète nationaliste haïtien, exécuté par le Président Nord Alexis en 1908.
[5] Poète haïtien de famille bourgeoise qui préférait vivre parmi les pauvres.
x
L’auteur :
x
Poète, romancier, enseignant et chercheur canadien d’adoption, haïtien d’âme et des entrailles. Ancien journaliste à la Radio Nationale d’Haïti dans les années 80. Haïti me tient par la gorge et m’entraîne avec elle dans ses tranchées de la colère et de la survivance, ces villes tentaculaires faites d’ombres et de lumières, mais surtout de vies mi-mortes et de morts vivantes. Pendant des décennies, je travaille à la forge des mots, dans ces laves où je remue volontiers les flammes de l’être. J’allie à ma cause la révolte contre la misère et le deuil, un romantisme lascif flirtant parfois avec l’inadmissible, une spiritualité en constante évolution qui fait de la foi son soleil et du doute ses lunes. Je commence à écrire à la fin des années 70, et comme un Van Gogh en poésie je me suis amusé avec le silence.